Académie nationale de Metz (1757-1793, 1819-)
Contenu
- Autre libellé
-
Société d’étude des sciences et arts de la ville de Metz
- Date
- 1757-1760
-
Société royale des sciences et des arts
- Date
- 1760-1790
-
Société des amis des sciences et des arts
- Date
- 1819-1828
-
Académie nationale de Metz
- Date
- 1828-1851
-
Académie impériale de Metz
- Date
- 1852-1870
- Type d'organisme
- Sociétés savantes
- Domaine d'activité
- Sciences
- Agronomie
- Histoire
- Description
-
L'Académie de Metz fut créée en avril 1757, par le maréchal duc de Belle-Isle, gouverneur des Trois Évêchés, sous le nom de « Société d’Étude des sciences et arts de la ville de Metz ». Elle est dotée d'une somme de 3000 livres et son assemblée siège dans les locaux nouvellement créés du Collège Saint-Louis du Fort, accueillie par le prieur et académicien Joseph de Saintignon. En juillet 1760, le roi Louis XV lui donne par lettres patentes le statut d’Académie royale et l'assemblée prend le nom de « Société royale des Sciences et des Arts ». Derrière le Duc de Belle-Isles, cousin du roi, se trouvent nommés de droit l'évêque, le commandant de la Province, le président du Parlement (justice), l'intendant de la Province, le maître échevin de la ville. Parmi les titulaires, M. Le Brun, professeur des mathématiques de l'École du Corps royal de l'artillerie et architecte de la ville, M. de Saintignon, chanoine régulier, supérieur du Collège royal de St Louis de la ville neuve à Metz, M. Lombard, professeur de mathématiques au Corps de l'artillerie.
Dans les années qui suivent la fondation, des concours sont régulièrement organisés sur une variété de thèmes. Parmi les lauréats, Robespierre est récompensé en 1784, sur la question de "l’origine de l’opinion qui étend sur tous les individus d’une même famille, une partie de la honte attachée aux peines infamantes que subit un coupable". L'abbé Grégoire se distingue lors du célèbre concours de 1787-1788 sur la "question juive". La suppression de l'Académie date de 1793 (an II de la République). Les activités dans les domaines des mathématiques et de la physique sont rassemblées dans les volumes 11 et 12 des archives de l'Académie. On note parmi les membres et intervenants réguliers Gardeur-Lebrun père et fils, Mauduit (trigonomie sphérique), Jean-Baptiste-Nicolas-François Dupré de Retonféy (1714-1800) (levée de terrain, géométrie, portraitiste).
En 1819, les procès-verbaux des premières séances relatent en détail la refondation. Depuis longtemps, plusieurs personnes avaient conçu le projet de former une société d’amis des lettres, sciences et arts. Ce fut au domicile de Dominique Mâcherez (1785-1857), un jeune maître de pension, qui habitait au 15, quai Saint-Pierre (aujourd’hui quai Félix-Maréchal), que tout commence le 14 mars 1819, à 10 heures du matin. Parmi les présents se trouvent Sarrazin, François Munier (1783-1863), Gentil, Gugnon, Herpin. Un règlement est ébauché et on fixe une prochaine réunion au 4 avril. Les mêmes, accrus de quelques autres, Gerson-Lévy (1784-1864), J. F. de Soleirol (1781-1863), le docteur M.J. Ibrelisle (1786-1866), procèdent à la création d’une Société des amis des lettres, sciences et arts, dont ils finalisent le règlement au cours des séances suivantes. On désigne le vieux M. de Saudray président honoraire, M. de Sarrazin président, Augustin Thiel (1787-1869) vice-président, Dominique Mâcherez (1785-1857) trésorier, et Jean-Charles Herpin (1798-1872) secrétaire. Un comité est chargé de prendre rendez-vous avec le maire, M. de Turmel (1770-1848). Ce dernier donne son aval et transmet au préfet, Hervé Clérel de Tocqueville (1772-1856). Un avis favorable est rendu; « La Société bannissant tout débat politique ou religieux de ses réunions, ne peut être jamais dangereuse ». À son tour, le préfet transmet la demande au ministre de l'Intérieur qui, par un arrêté du 22 mai 1819, autorise la nouvelle Société sous le titre de « Réunion des amis des lettres. sciences et arts ». Turmel et Tocqueville sont tous deux nommés membres honoraires. Le 20 janvier 1820, par autorisation du maire, la Société déménage dans la bibliothèque des Petits Carmes. La devise de la première société « Utilitati publicae » est actualisée en « L'Utile ». La première séance générale publique, au cours de laquelle les travaux de l'année universitaire sont présentés, se déroule à l’hôtel de ville, le 15 avril 1821.
La nouvelle académie met comme l'ancienne des questions au concours et récompense les réponses. Une publicité des questions mises au concours est faite dans le « Journal des savans » de juillet 1821. La séance publique annuelle au cours de laquelle sont distribués des prix littéraires, artistiques et scientifiques est instaurée en 1823. Des questions pédagogiques traversent les débats de cette époque. Au niveau national, le polytechnicien Charles Dupin (1784-1873), professeur aux Arts et Métiers à Paris, promeut une instruction des ouvriers et artisans en géométrie et mécanique conduite par les polytechniciens. De 1820 à 1835, les polytechniciens Bergery (1787-1863), Poncelet (1788-1867), Munier (1790-1838), Gosselin (1791-1862) organisent, avec le soutien de la municipalité et du préfet, un enseignement industriel gratuit. Le 15 septembre 1825, suite à l'appel de Bergery, une première femme est reçue par la Société, la poétesse messine Amable Tastu (1795-1885).
Dès 1823, la Société, soutenue par le maire Turmel et le préfet Tocqueville, organise une première exposition des produits des arts, de l’industrie, de l’agriculture et de l’horticulture du département de la Moselle, jumelée avec la traditionnelle foire de mai. On récompense, parmi nombre de lauréats, le faïencier de Sarreguemines Paul Utzschneider (1771-1844), reçu ensuite comme membre correspondant, et le maître de forges François de Wendel (1778-1825). Des médailles sont remises à 42 des 132 exposants. Le Conseil général promet de soutenir par une subvention une exposition régulière. Celles-ci vont se dérouler de nouveau en 1826,1828, 1843, 1849, 1861. Pour l'exposition de 1828, Charles X se déplace à Metz, et le titre d’Académie royale est accordé à la Société, le 5 septembre 1828. A partir de 1852, des liaisons ferroviaires relient Metz à Nancy, Paris et Berlin. Parrainée par l'impératrice Eugénie, l'exposition universelle de 1861 réunit alors 1 425 exposants. Les produits de l’industrie sont répartis en douze classes et dans chacune d’elles, le jury attribue des récompenses consistant en médailles d’or, de vermeil, d’argent et de bronze, mentions honorables et primes d’honneur.
L’Annexion de 1870 voit le repli d'une partie des académiciens à Nancy où se constitue une section particulière à l'Académie Stanislas. L'Académie de Metz maintient ses publications, en français et en allemand. Le déclenchement de la guerre en 1914 oblige à la suspension des activités. En 1919, l'Académie peut à la fois célébrer le retour de Metz à la France et le centenaire de sa refondation. Interdite par les autorités allemandes en 1940, elle est rétablie en 1945. L'Académie siège actuellement au 20 en Nexirue à Metz, face à l'Hôtel de Gargan.
Les Mémoires de l'Académie sont accessibles au format numérique. Les archives manuscrites antérieures à la révolution se trouvent numérisées sur Limédia, la plateforme numérique du sillon lorrain. Les mémoires de la seconde Académie peuvent être interrogés et visionnés sur Gallica et pour un certain nombre de volumes sur Google Books. La seconde académie et ses activités mathématiques, de 1821 à 1870, constitue le sujet du chapitre 9 du livre, écrit par Philippe Nabonnand en 2017. Constitué par Hélène Thomas-Bouter et Pierre Couchet en 2025, un fichier recense les URL des Mémoires de l'Académie sur Gallica et Google Livres, de 1821 à 1870 et au-delà. - Source
- https://academiemetz.fr/
- Lettres patentes pour l'établissement d'une Société royale des Sciences et des Arts dans la ville de Metz. Archives de l'Académie de Metz. 1760. Volume 3
- Liste des Académiciens. Archives de l'Académie de Metz. 1760. Volume 3
- Concours de 1821 à l'Académie de Metz, Journal des Savans, juillet 1821
- L'émancipation des Juifs devant la Société royale des Sciences et Arts de Metz en 1787 et M. Rœderer, par Abraham Cahen, 1880
- Archives manuscrites et imprimées d'Ancien régime (1757-1790), Limédia
- Société des lettres, sciences et arts de Metz. (1819-1826), Gallica
- Mémoires de l'Académie nationale de Metz (1827-2020), Gallica
- Liste des membres de l'Académie, expositions, concours, depuis 1819 jusqu'à 1903, par l'Académie
- De la Société des lettres, sciences et arts de 1819 à l’Académie royale de 1828, par Gérard Nauroy, 2020
- Année de création - fermeture
- 1760-1793
- 1819
- Année de création
- 1760
- Titre
- Académie nationale de Metz (1757-1793, 1819-)
- Employé, affecté, membre
- Casbois, Nicolas (1728-1795, dom)
- Gardeur-Lebrun, Louis (1714-1786)
-
 Saintignon, Joseph de, Abbé (1716-1795)
Saintignon, Joseph de, Abbé (1716-1795)
-
Gardeur-Lebrun, Claude (1745-1828)
- Date
- 1778-1790
-
Mâcherez, Dominique (1785-1857)
- Date
- 1819-1857
-
Lévy, Gerson (1784-1864)
- Date
- 1819-1864
- Noël, Jean-Nicolas (1783-1867)
-
Bergery, Claude-Lucien (1787-1863)
- Date
- 1820-1835
-
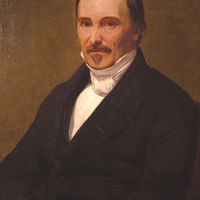 Poncelet, Jean-Victor (1788-1867)
Poncelet, Jean-Victor (1788-1867)
- Date
- 1820-1867
-
Munier, Dominique-Nicolas (1790-1838)
- Date
- 1821-1838
-
 Gargan, Théodore-Charles-Joseph (1791-1853)
Gargan, Théodore-Charles-Joseph (1791-1853)
- Date
- 1821-1853
-
 Olivier, Théodore (1793-1853)
Olivier, Théodore (1793-1853)
- Date
- 1821-1853
-
Woisard, Jean-Louis (1797-1828)
- Date
- 1821-1828
-
 Dupin, Charles (1784-1873)
Dupin, Charles (1784-1873)
- Date
- 1823
-
Devilly, Louis Jean Baptiste (1792-1826)
- Date
- 1823-1826
-
Coste, Louis Marie Prosper (1793-1875)
- Date
- 1826-
-
Gosselin, Théodore-François (1791-1862)
- Date
- 1827-1862
-
 Lasaulce , Jean Adolphe (1799-1865)
Lasaulce , Jean Adolphe (1799-1865)
-
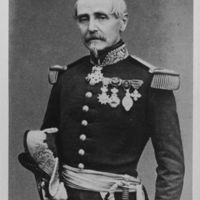 Didion, Isidore (1798-1878)
Didion, Isidore (1798-1878)
- Date
- 1826-1878
-
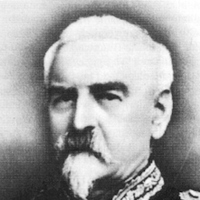 Susane, Louis Auguste Victor Vincent (1810-1876)
Susane, Louis Auguste Victor Vincent (1810-1876)
-
 Dembour, Adrien (1799-1887)
Dembour, Adrien (1799-1887)
- Date
- 1837
- Virlet, François Édouard (1810-1889)
-
Blanc, Jean-François (1800-1886)
- Profession
- Secrétaire
- Date
- 1845-1846
- Maréchal, François, abbé (1795-1860)
-
Vincenot, L-L (18?-1878)
- Date
- 1847-1865
-
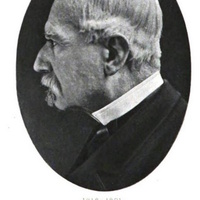 Goulier, Charles-Moÿse (1818-1891)
Goulier, Charles-Moÿse (1818-1891)
- Date
- 1864-1868?
- URI de l'item dans les bases Idref, catalogue.bnf.fr, isni, Wikidata
- https://www.idref.fr/026489945
- https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11872859g
- https://isni.org/isni/0000000123484579
- https://www.wikidata.org/wiki/Q2822435
- http://cths.fr/an/societe.php?id=1770
- Classe de ressource
- Organization
La Société royale des sciences et arts (1757-1793) accueillie au Collège Saint-Louis du Fort
Contenu : “Académie nationale de Metz (1757-1793, 1819-)”
Académie de Metz en Nexirue (183?-)
Contenu : “Académie nationale de Metz (1757-1793, 1819-)”
Refondation de l'Académie de Metz chez Mâcherez, le 14 mars 1819
Contenu : “Académie nationale de Metz (1757-1793, 1819-)”
L'Académie de Metz dans la bibliothèque municipale (1820-183?)
Contenu : “Académie nationale de Metz (1757-1793, 1819-)”
Ressources liées
| Titre | Classe |
|---|---|
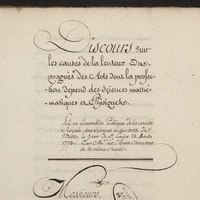 Archives de l'Académie royale de Metz (1757-1793) Archives de l'Académie royale de Metz (1757-1793) |
Périodique |
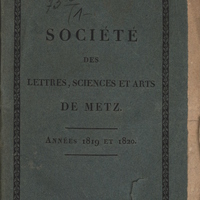 Mémoires de l'Académie nationale de Metz (1819-) Mémoires de l'Académie nationale de Metz (1819-) |
Périodique |
| Titre | Classe |
|---|---|
| IX. L'activité et la sociabilité mathématiques à Metz entre 1821 et 1870 vues à partir des Mémoires de l'Académie de Metz | Document |
| Titre | Classe |
|---|---|
| Expositions industrielles de Metz et de la Moselle (1823, 1826, 1828, 1843, 1849, 1861) | Périodique |