Contenus
Classe
Périodique
Site
MathsInMetz
-
Journal des savants (1665-1792, 1797, 1816-)Périodiques de recherche; 1665-1792; 1797; 1816-;Pourvu en août 1664 d'un privilège qui accorde à la nouvelle revue un champ universel, des beaux-arts aux sciences, du droit à la religion, pour les livres, les mémoires et aussi les représentations ou démonstrations publiques, le premier éditeur Denis de Sallo établit pour l'élaboration de sa revue des échanges avec des savants d'Angleterre, des Pays-Bas et de Toscane. Le journal s'attache spécialement à la revue des ouvrages de sciences et d'histoire, il présente aussi des livres religieux de même quelques œuvres littéraires. Le format quarto en 12 pages est retenu, avec, jusqu'en 1723, une fréquence de parution hebdomadaire. De 1724 à 1792, date de l'arrêt décidé par Danton, la parution est mensuelle. La publication de tables annuelles commence en 1666 : un répertoire bibliographique des livres parus dans l'année est publié, accompagné d'un classement par discipline scientifique, tout d'abord en latin. Sont notamment distinguées les douze catégories en latin : 1/ "Biblia sacra", 2/ "Patres theologi" 3/ "Juridici et politici" 4/ "Historia sacra et profana", 5/ "Antiquitates historicae" 6/ "Philosophia, Mathematica", 7/ "Artes" (arts et métiers), 8/ "Historia naturalis", 9/ "Medici", 10/ Oratores, 11/ Poetae, 12/ Miscellanei. En 1797, un rétablissement du Journal est tenté, dans le sillage de la création des écoles centrales et de l'Institut de France. La revue, devenue bimestrielle, offre mémoires, nouvelles littéraires et comptes rendus des différentes classes de l'Institut. Mais faute de lecteurs, elle s’arrête au bout d'un semestre après douze numéros. En 1816, changement de régime politique. Plusieurs membres du groupe des refondateurs renouvèlent leur tentative et ils obtiennent du Garde des sceaux la tutelle de l'Institut. Plusieurs nouvelles séries, correspondant à chaque fois à des transformations éditoriales, sont ensuite publiées jusqu’en 1859. En 1909, le journal cesse d’être l’organe de l’Institut pour devenir, comme actuellement, celui de l’Académie des inscriptions et belles-lettres. En matière de contenu, les activités de personnalités messines, de même que celles de la Société royale, sont mentionnées dès 1765. Jacques-Ch.-François de La Perriere de Roiffé, membre de la Société Royales des Sciences & des Arts de Metz, adresse une lettre au journal, critique d'un ouvrage d'astronomie publié par de la Lande (Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande). Il est l'auteur d'un livre de vulgarisation de l'astronomie Nouvelle Physique Céleste et Terrestre à la portée de tout le monde. Mauduit, maitre de mathématique à Paris et professeur à Metz, dépose un mémoire en réponse à un concours de mathématiques. L'année d'après, il publie à Paris, avec trois planches, Principes d'astronomie sphérique, ou Traité complet de Trigonométrie sphérique.
-
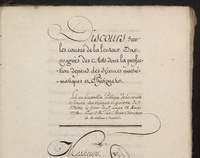 Archives de l'Académie royale de Metz (1757-1793)Archives; 1757-1793; Académie nationale de Metz (1757-1793, 1819-);
Les archives de l'Académie royale de Metz rassemblent en 15 volumes des pièces manuscrites d'ancien régime, produites lors des successives séances et réunions. En 1905, les pièces des boîtes sont inventoriées et numérotées par Élie Fleur (1864-1957), bibliothécaire et historien messin. L'ensemble a été numérisé et se trouve maintenant disponible sur Limédia, la plateforme multimédia ouverte du sillon lorrain. Certains volumes, la boîte 11 notamment, contiennent des manuscrits d'intérêt sur les mathématiques, la physique et l'artillerie. Parmi les textes, on peut signaler "Discours sur les causes de la lenteur du progrès des arts, dont la perfection dépend des sciences mathématiques et physiques – par Mr Gardeur Le Brun [père], – et programme du concours pour 1774, publié par Mr Dupré de Geneste [Henri-Marie Dupré de Geneste], – le tout, 25 aoust 1773", une traduction par Gardeur-Lebrun fils du latin en français de la trigonométrie sphérique de l'abbé jésuite Boscovich, d'autres textes encore. Classé chronologiquement, le volume 15 contient des pièces sur les arts [les sciences] de l’ingénieur. Un exemple avec figure concerne le fonctionnement d'une pompe nommée "Machine à épuiser", dédiée à l'assèchement des sous-sols, par Gardeur-Lebrun fils, en 1790. Des correspondances complètent l'ensemble.
Archives de l'Académie royale de Metz (1757-1793)Archives; 1757-1793; Académie nationale de Metz (1757-1793, 1819-);
Les archives de l'Académie royale de Metz rassemblent en 15 volumes des pièces manuscrites d'ancien régime, produites lors des successives séances et réunions. En 1905, les pièces des boîtes sont inventoriées et numérotées par Élie Fleur (1864-1957), bibliothécaire et historien messin. L'ensemble a été numérisé et se trouve maintenant disponible sur Limédia, la plateforme multimédia ouverte du sillon lorrain. Certains volumes, la boîte 11 notamment, contiennent des manuscrits d'intérêt sur les mathématiques, la physique et l'artillerie. Parmi les textes, on peut signaler "Discours sur les causes de la lenteur du progrès des arts, dont la perfection dépend des sciences mathématiques et physiques – par Mr Gardeur Le Brun [père], – et programme du concours pour 1774, publié par Mr Dupré de Geneste [Henri-Marie Dupré de Geneste], – le tout, 25 aoust 1773", une traduction par Gardeur-Lebrun fils du latin en français de la trigonométrie sphérique de l'abbé jésuite Boscovich, d'autres textes encore. Classé chronologiquement, le volume 15 contient des pièces sur les arts [les sciences] de l’ingénieur. Un exemple avec figure concerne le fonctionnement d'une pompe nommée "Machine à épuiser", dédiée à l'assèchement des sous-sols, par Gardeur-Lebrun fils, en 1790. Des correspondances complètent l'ensemble. -
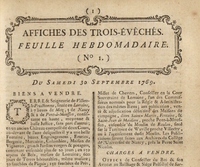 Affiches des Trois-Évêchés (1769-1779)Journalisme et journaux en France - Moselle; 1769-1779; Cordier de Clermont; Brondex, Albert (1737-1797);
A parution hebdomadaire, le premier numéro des "Affiches des Trois-Évêchés" sort le 30 septembre 1769. Plusieurs périodiques de ce type voient le jour à Paris "Affiches de Paris (1746-1750)" et en province "Affiches de Reims (1772-1780)", "Affiches de Strasbourg (1789-1800)". Les Affiches publient en premier lieu des petites annonces locales et légales, des nouvelles locales, nationales et internationales. Le reste concerne des spectacles, des résumés de livres, les sciences et arts, le prix des grains et fourrages et aussi, en ce qui concerne Metz, des nouvelles des mouvements des régiments militaires. Créé par Cordier de Clermont, l'hebdomadaire est imprimé en premier lieu par Joseph Antoine, imprimeur royal à Metz, ville dans laquelle deux imprimeurs au maximum peuvent obtenir le droit d'imprimer sous l'ancien régime. Les Affiches changent rapidement de propriétaire. A la fin de l’année 1770, elles sont rachetées par Albert Brondex (1737-1797) dont les bureaux sont à son domicile en Fournirue. Brondex obtient la direction du journal par l'entremise de son beau-frère Louis Gentil, régisseur du château de Pange. Un supplément en 4 pages à parution irrégulière et à vocation juridique est ajouté en 1771, dont le premier numéro est intitulé "Avis sur un objet très intéressant qui va désormais faire partie des petites affiches des Trois-Evêchés". 20 parutions suivent sous le titre "Arrêts du Parlement de Metz. Qui préjugent des questions de Droit, avec les motifs qui ont déterminé à les rendre". En 1773, un élargissement de l'audience à la Lorraine est entrepris et le journal devient "Affiches, Annonces, et Avis divers pour les Trois-Évêchés et la Lorraine". Les activités de Brondex se diversifient alors. A partir de 1775, le journaliste prend à bail avec son épouse, la terre et seigneurie de Villers au Bois, localisée non loin d’Épernay (par. Saint-Marcel de Metz, A.D. Moselle, E 177). Parmi les exemples de petites annonces en relation avec MathsInMetz, on trouve dans le numéro 30 de 1770 : "Le Sr. Cadet fils se propose d’établir en cette Ville une salle de Dessin concernant l'architecture civile & militaire, & voici son projet. La Géométrie sera le fondement de ses leçons, mais la pratique dominera sur la Théorie, il en fera construire proprement les figures, il en expliquera la construction avec le plus de clarté, de netteté & de précision qu’il lui sera possible; il découvrira les usages, des propositions dans les autres parties des Mathématiques. Afin de bien pénétrer L’esprit de ses éleves de leur utilité, de leur nécessité, il éloignera tout ce qui n’est que simple théorie, tout sera démontré linéairement , tout sera rappellé à l’usage & appliqué à la pratique; ainsi une régie, un compas, une équerre, un crayon, voilà les instrumens pratiques qu’il mettra d’abord à la main de ses éleves". Dans le même genre, paru au numéro 33 de 1778 : "Le sieur Charmoillaux , ci-devant Appointé dans l’Artillerie, Régiment de Besançon, nouvellement établi en cette Ville, donne avis qu’il toise, arpente, lève & décline les plans, soit de bâtiment, de terrains ou de fortifications , ainsi que les façades , élévations & profils de Maisons & de machines; il enseigne aussi la Carte, les Mathématiques, le dessin susdit. Il fera démontrer sur le terrain à ses Écoliers ce qu’ils sauront exécuter dans le Cabinet, & leur enseignera la manière de se servir de différents instruments de Mathématiques, comme le Graphomètre, la Boussole, la planchette &c.". A partir de 1780, Brondex fait évoluer de manière majeure son format. Celui-ci devient imprimé en 8 pages sous le titre "Affiches des Évêchés et Lorraine". Pour chaque année, les feuilles sont numérotées de manière croissante. Au final, le tableau des parutions est le suivant : année; parutions; pages écrites; titre principal; imprimeur; format 1769; 14; 53; Affiches des Trois-Évêchés, feuille hebdomadaire; Joseph Antoine; 4 pages 1770; 52; 208; Affiches des Trois-Évêchés, feuille hebdomadaire; Joseph Antoine; 4 pages 1771; 52; 208; Affiches des Trois-Évêchés, feuille hebdomadaire; Joseph-Pierre Collignon; 4 pages 1771-1772; 20; 80; Arrêts du Parlement de Metz. Qui préjugent des questions de Droit, avec les motifs qui ont déterminé à les rendre; Joseph-Pierre Collignon; 4 pages supplément irrégulier ? 1772; 52; 238; Affiches des Trois-Évêchés, feuille hebdomadaire; Joseph-Pierre Collignon; 4 pages 1773; 52; 214; Affiches, Annonces, et Avis divers pour les Trois-Évêchés et la Lorraine; Jean-Baptiste Collignon; 4 pages 1773; 10; 40; Supplément aux Affiches de Lorraine et des Trois-Évêchés; 1774; 52; 228; Affiches, Annonces, et Avis divers pour les Trois-Évêchés et la Lorraine; Jean-Baptiste Collignon; 4 pages 1775; 52; 222; Affiches, Annonces, et Avis divers pour les Trois-Évêchés et la Lorraine; Jean-Baptiste Collignon; 4 pages 1776; 52; 180; Affiches, Annonces, et Avis divers pour les Trois-Évêchés et la Lorraine; Joseph Antoine; 4 pages 1777; 52; 188; Affiches, Annonces, et Avis divers pour les Trois-Évêchés et la Lorraine; Joseph Antoine; 4 pages 1778; 52; 188; Affiches, Annonces, et Avis divers pour les Trois-Évêchés et la Lorraine; Joseph Antoine; 4 pages 1779; non publié, non numérisé ? 1780; 52; 417; Affiches des Évêchés et Lorraine; J. Antoine; 8 pages
Affiches des Trois-Évêchés (1769-1779)Journalisme et journaux en France - Moselle; 1769-1779; Cordier de Clermont; Brondex, Albert (1737-1797);
A parution hebdomadaire, le premier numéro des "Affiches des Trois-Évêchés" sort le 30 septembre 1769. Plusieurs périodiques de ce type voient le jour à Paris "Affiches de Paris (1746-1750)" et en province "Affiches de Reims (1772-1780)", "Affiches de Strasbourg (1789-1800)". Les Affiches publient en premier lieu des petites annonces locales et légales, des nouvelles locales, nationales et internationales. Le reste concerne des spectacles, des résumés de livres, les sciences et arts, le prix des grains et fourrages et aussi, en ce qui concerne Metz, des nouvelles des mouvements des régiments militaires. Créé par Cordier de Clermont, l'hebdomadaire est imprimé en premier lieu par Joseph Antoine, imprimeur royal à Metz, ville dans laquelle deux imprimeurs au maximum peuvent obtenir le droit d'imprimer sous l'ancien régime. Les Affiches changent rapidement de propriétaire. A la fin de l’année 1770, elles sont rachetées par Albert Brondex (1737-1797) dont les bureaux sont à son domicile en Fournirue. Brondex obtient la direction du journal par l'entremise de son beau-frère Louis Gentil, régisseur du château de Pange. Un supplément en 4 pages à parution irrégulière et à vocation juridique est ajouté en 1771, dont le premier numéro est intitulé "Avis sur un objet très intéressant qui va désormais faire partie des petites affiches des Trois-Evêchés". 20 parutions suivent sous le titre "Arrêts du Parlement de Metz. Qui préjugent des questions de Droit, avec les motifs qui ont déterminé à les rendre". En 1773, un élargissement de l'audience à la Lorraine est entrepris et le journal devient "Affiches, Annonces, et Avis divers pour les Trois-Évêchés et la Lorraine". Les activités de Brondex se diversifient alors. A partir de 1775, le journaliste prend à bail avec son épouse, la terre et seigneurie de Villers au Bois, localisée non loin d’Épernay (par. Saint-Marcel de Metz, A.D. Moselle, E 177). Parmi les exemples de petites annonces en relation avec MathsInMetz, on trouve dans le numéro 30 de 1770 : "Le Sr. Cadet fils se propose d’établir en cette Ville une salle de Dessin concernant l'architecture civile & militaire, & voici son projet. La Géométrie sera le fondement de ses leçons, mais la pratique dominera sur la Théorie, il en fera construire proprement les figures, il en expliquera la construction avec le plus de clarté, de netteté & de précision qu’il lui sera possible; il découvrira les usages, des propositions dans les autres parties des Mathématiques. Afin de bien pénétrer L’esprit de ses éleves de leur utilité, de leur nécessité, il éloignera tout ce qui n’est que simple théorie, tout sera démontré linéairement , tout sera rappellé à l’usage & appliqué à la pratique; ainsi une régie, un compas, une équerre, un crayon, voilà les instrumens pratiques qu’il mettra d’abord à la main de ses éleves". Dans le même genre, paru au numéro 33 de 1778 : "Le sieur Charmoillaux , ci-devant Appointé dans l’Artillerie, Régiment de Besançon, nouvellement établi en cette Ville, donne avis qu’il toise, arpente, lève & décline les plans, soit de bâtiment, de terrains ou de fortifications , ainsi que les façades , élévations & profils de Maisons & de machines; il enseigne aussi la Carte, les Mathématiques, le dessin susdit. Il fera démontrer sur le terrain à ses Écoliers ce qu’ils sauront exécuter dans le Cabinet, & leur enseignera la manière de se servir de différents instruments de Mathématiques, comme le Graphomètre, la Boussole, la planchette &c.". A partir de 1780, Brondex fait évoluer de manière majeure son format. Celui-ci devient imprimé en 8 pages sous le titre "Affiches des Évêchés et Lorraine". Pour chaque année, les feuilles sont numérotées de manière croissante. Au final, le tableau des parutions est le suivant : année; parutions; pages écrites; titre principal; imprimeur; format 1769; 14; 53; Affiches des Trois-Évêchés, feuille hebdomadaire; Joseph Antoine; 4 pages 1770; 52; 208; Affiches des Trois-Évêchés, feuille hebdomadaire; Joseph Antoine; 4 pages 1771; 52; 208; Affiches des Trois-Évêchés, feuille hebdomadaire; Joseph-Pierre Collignon; 4 pages 1771-1772; 20; 80; Arrêts du Parlement de Metz. Qui préjugent des questions de Droit, avec les motifs qui ont déterminé à les rendre; Joseph-Pierre Collignon; 4 pages supplément irrégulier ? 1772; 52; 238; Affiches des Trois-Évêchés, feuille hebdomadaire; Joseph-Pierre Collignon; 4 pages 1773; 52; 214; Affiches, Annonces, et Avis divers pour les Trois-Évêchés et la Lorraine; Jean-Baptiste Collignon; 4 pages 1773; 10; 40; Supplément aux Affiches de Lorraine et des Trois-Évêchés; 1774; 52; 228; Affiches, Annonces, et Avis divers pour les Trois-Évêchés et la Lorraine; Jean-Baptiste Collignon; 4 pages 1775; 52; 222; Affiches, Annonces, et Avis divers pour les Trois-Évêchés et la Lorraine; Jean-Baptiste Collignon; 4 pages 1776; 52; 180; Affiches, Annonces, et Avis divers pour les Trois-Évêchés et la Lorraine; Joseph Antoine; 4 pages 1777; 52; 188; Affiches, Annonces, et Avis divers pour les Trois-Évêchés et la Lorraine; Joseph Antoine; 4 pages 1778; 52; 188; Affiches, Annonces, et Avis divers pour les Trois-Évêchés et la Lorraine; Joseph Antoine; 4 pages 1779; non publié, non numérisé ? 1780; 52; 417; Affiches des Évêchés et Lorraine; J. Antoine; 8 pages -
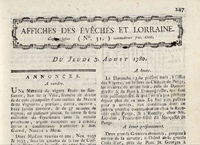 Affiche des Évêchés et Lorraine (1780-1790)Journalisme et journaux en France - Moselle; 1780-1790; Blouet, Jean-François (1745-1809);
Le titre "Affiche des Évêchés et Lorraine" en 8 pages sur 2 colonnes paraît de manière stable à partir de 1780. En plus de l'éditions de son journal, Brondex entreprend une diversification de ses activités. En 1775, il prend bail avec son épouse de la terre et seigneurie de Villers au Bois, localisée non loin d’Épernay. Il se charge aussi de la gérance des biens de M. de Flavigny. Ce dernier ne pouvant obtenir le paiement du revenu de ses terres le fait incarcérer en 1781. Brondex cède alors son titre à l'avocat du Parlement, Jean-François Blouet (1745-1809) qui en devient le directeur et rédacteur à compter du 1er janvier 1782. Brondex publie ensuite des textes et poésies en patois. Il se rend à Paris. En 1794, il tente de publier "Le Journal du peuple français" dont un seul exemplaire est connu. Le titre "Affiche des Évêchés et Lorraine" continue de paraître tel que précédemment. Blouet et la rédaction restent localisés en Fournirue. Les imprimeurs sont successivement Joseph Antoine, puis Claude Lamort à partir de décembre 1784, tous deux installés à Metz avec privilège. On souscrit à Metz, Nancy et vers 1789 Verdun. Le 7 janvier 1790, parait "Supplément aux Affiches des Évêchés et Lorraine", périodique en 4 pages qui relate trois fois par semaine les discussions menées par l'Assemblée nationale à Paris. Alors que les Affiches restent publiées une fois par semaine le jeudi, le supplément l'est les mardi, jeudi et dimanche. Le 1er mai 1790, le supplément est renommé "Annales nationales et politiques". La numérotation courante des pages de l'année est maintenue. À partir du 15 juillet 1790, date symbolique forte, sort un journal en deux parties éditorialement plus stable. Les Affiches sont renommées "Journal des départements de la Moselle, de la Meurthe, de la Meuse, des Ardennes et des Vosges" et sortent toujours le jeudi de chaque semaine. Elles contiennent en 8 pages numérotées des petites annonces, nouvelles locales, politiques sciences et arts, prix des grains. Les "Annales Nationales et Politiques" continuent leur parution tri-hebdomadaire. Les nouvelles politiques nationales sont diffusées avec un retard d'une semaine environ sur les événements parisiens. Parmi les annonces, on lit ainsi dans les Affiches du 7 janvier 1790 : "Le sieur Lamort Imprimeur à Nancy qui a fait l’acquisition du Privilège de l’Almanach de Lorraine que possédoit feue Mme. Charlot, annonce qu'il a donné cette année tous les soins pour que cet ouvrage soit digne de l'attention du Public". Des "Avis divers" concernent l'édition ou l'enseignement primaire : "Un Ecclésiastique habitant la campagne prend des pensionnaires de l’âge depuis 9 jusqu'à 15 ans auxquels il enseigne le latin, l’allemand, la géographie, l’histoire, & les premiers élémens des mathématiques. [...] moyennant cent écus de pension, dont moitié payable en entrant". année; parutions par année; pages par année; titre principal; imprimeur; format 1780; 52; 417; Affiches des Évêchés et Lorraine; Joseph Antoine; 8 pages 1781; 52; 418; Affiches des Évêchés et Lorraine; Joseph Antoine; 8 pages 1782; 49; 408; Affiches des Évêchés et Lorraine; Joseph Antoine; 8 pages; irrégulier 1783; 51; 416; Affiches des Évêchés et Lorraine; Joseph Antoine; 8 pages 1784; 52; 424; Affiches des Évêchés et Lorraine; Joseph Antoine, Claude Lamort; 8 pages 1785; 52; 416; Affiches des Évêchés et Lorraine; Claude Lamort; 8 pages 1786; 49; 408; Affiches des Évêchés et Lorraine; Claude Lamort; 8 pages 1787; 51; 416; Affiches des Évêchés et Lorraine; Claude Lamort; 8 pages 1788; 50; 416; Affiches des Évêchés et Lorraine; Claude Lamort; 8 pages 1789; 52; 434; Affiches des Évêchés et Lorraine; Claude Lamort; 8 pages 1790; 26; 216; Affiches des Évêchés et Lorraine; Claude Lamort; 8 pages 1790; 47; 188; Supplément aux Affiches des Évêchés et Lorraine; Claude Lamort; 4 pages 1790; 48-93; 188-372; Annales Nationales et Politiques; Claude Lamort; 4 pages 1790; ; ; Journal des départements de la Moselle, de la Meurthe, de la Meuse, des Ardennes et des Vosges (1790-1806)
Affiche des Évêchés et Lorraine (1780-1790)Journalisme et journaux en France - Moselle; 1780-1790; Blouet, Jean-François (1745-1809);
Le titre "Affiche des Évêchés et Lorraine" en 8 pages sur 2 colonnes paraît de manière stable à partir de 1780. En plus de l'éditions de son journal, Brondex entreprend une diversification de ses activités. En 1775, il prend bail avec son épouse de la terre et seigneurie de Villers au Bois, localisée non loin d’Épernay. Il se charge aussi de la gérance des biens de M. de Flavigny. Ce dernier ne pouvant obtenir le paiement du revenu de ses terres le fait incarcérer en 1781. Brondex cède alors son titre à l'avocat du Parlement, Jean-François Blouet (1745-1809) qui en devient le directeur et rédacteur à compter du 1er janvier 1782. Brondex publie ensuite des textes et poésies en patois. Il se rend à Paris. En 1794, il tente de publier "Le Journal du peuple français" dont un seul exemplaire est connu. Le titre "Affiche des Évêchés et Lorraine" continue de paraître tel que précédemment. Blouet et la rédaction restent localisés en Fournirue. Les imprimeurs sont successivement Joseph Antoine, puis Claude Lamort à partir de décembre 1784, tous deux installés à Metz avec privilège. On souscrit à Metz, Nancy et vers 1789 Verdun. Le 7 janvier 1790, parait "Supplément aux Affiches des Évêchés et Lorraine", périodique en 4 pages qui relate trois fois par semaine les discussions menées par l'Assemblée nationale à Paris. Alors que les Affiches restent publiées une fois par semaine le jeudi, le supplément l'est les mardi, jeudi et dimanche. Le 1er mai 1790, le supplément est renommé "Annales nationales et politiques". La numérotation courante des pages de l'année est maintenue. À partir du 15 juillet 1790, date symbolique forte, sort un journal en deux parties éditorialement plus stable. Les Affiches sont renommées "Journal des départements de la Moselle, de la Meurthe, de la Meuse, des Ardennes et des Vosges" et sortent toujours le jeudi de chaque semaine. Elles contiennent en 8 pages numérotées des petites annonces, nouvelles locales, politiques sciences et arts, prix des grains. Les "Annales Nationales et Politiques" continuent leur parution tri-hebdomadaire. Les nouvelles politiques nationales sont diffusées avec un retard d'une semaine environ sur les événements parisiens. Parmi les annonces, on lit ainsi dans les Affiches du 7 janvier 1790 : "Le sieur Lamort Imprimeur à Nancy qui a fait l’acquisition du Privilège de l’Almanach de Lorraine que possédoit feue Mme. Charlot, annonce qu'il a donné cette année tous les soins pour que cet ouvrage soit digne de l'attention du Public". Des "Avis divers" concernent l'édition ou l'enseignement primaire : "Un Ecclésiastique habitant la campagne prend des pensionnaires de l’âge depuis 9 jusqu'à 15 ans auxquels il enseigne le latin, l’allemand, la géographie, l’histoire, & les premiers élémens des mathématiques. [...] moyennant cent écus de pension, dont moitié payable en entrant". année; parutions par année; pages par année; titre principal; imprimeur; format 1780; 52; 417; Affiches des Évêchés et Lorraine; Joseph Antoine; 8 pages 1781; 52; 418; Affiches des Évêchés et Lorraine; Joseph Antoine; 8 pages 1782; 49; 408; Affiches des Évêchés et Lorraine; Joseph Antoine; 8 pages; irrégulier 1783; 51; 416; Affiches des Évêchés et Lorraine; Joseph Antoine; 8 pages 1784; 52; 424; Affiches des Évêchés et Lorraine; Joseph Antoine, Claude Lamort; 8 pages 1785; 52; 416; Affiches des Évêchés et Lorraine; Claude Lamort; 8 pages 1786; 49; 408; Affiches des Évêchés et Lorraine; Claude Lamort; 8 pages 1787; 51; 416; Affiches des Évêchés et Lorraine; Claude Lamort; 8 pages 1788; 50; 416; Affiches des Évêchés et Lorraine; Claude Lamort; 8 pages 1789; 52; 434; Affiches des Évêchés et Lorraine; Claude Lamort; 8 pages 1790; 26; 216; Affiches des Évêchés et Lorraine; Claude Lamort; 8 pages 1790; 47; 188; Supplément aux Affiches des Évêchés et Lorraine; Claude Lamort; 4 pages 1790; 48-93; 188-372; Annales Nationales et Politiques; Claude Lamort; 4 pages 1790; ; ; Journal des départements de la Moselle, de la Meurthe, de la Meuse, des Ardennes et des Vosges (1790-1806) -
Gazette nationale ou le Moniteur universel (1789-1901)Périodiques officiels; 1789-1901;Créée le 24 novembre 1789 par Charles-Joseph Panckoucke, la "Gazette nationale ou Moniteur universel" est publiée jusqu'en 1901. Le quotidien retranscrit fidèlement les débats et délibérations des assemblées législatives. La feuille devient, à partir de la révolution et jusqu'en 1868, l’organe officiel du gouvernement français. Elle se divise en deux parties, la première, traite des travaux et décisions des assemblées et de l'État; la seconde, concerne les événements marquants de la politique intérieure et étrangère de la France, des arts, des lettres et des sciences. À la fin de l’année 1868, le monopole de l’information officielle revient au "Journal officiel". La diffusion du Moniteur diminue ensuite progressivement (14 000 exemplaires en 1880). En 1902 – alors qu'il entame sa 113e année de publication – Le "Moniteur universel" fusionne avec "Le Soleil" et la parution cesse. En 2018, la BnF met en ligne une version numérique du Moniteur, journal particulièrement important pour les études historiques datées de la Révolution au début du 20e siècle. Les contenus se montrent possibles à chercher depuis l'interface de RetroNews.
-
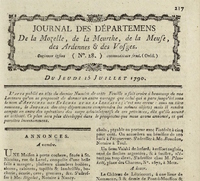 Journal des départements de la Moselle, de la Meurthe, de la Meuse, des Ardennes et des Vosges (1790-1806)Journalisme et journaux en France - Moselle; 1790-1806; Blouet, Jean-François (1745-1809);
Le 15 janvier 1790, l’Assemblée constituante issue de la Révolution française vote la réorganisation du territoire français en 83 départements dont les limites respectent en partie le tracé des anciennes provinces. Prenant acte de cette décision, Blouet renomme les Affiches en "Journal des départements de la Mozelle, de la Meurthe, de la Meuse, des Ardennes et des Vosges". On remarque au passage l'orthographe initiale de la Moselle. Le premier numéro parait le 15 juillet 1790, augmenté du supplément "Annales nationales et politiques", dans lequel les délibérations de l'assemblée nationale paraissent. La périodicité du journal va varier : hebdomadaire; bidécadaire (24 déc. 1794-19 nov. 1796 ; 22 août 1798-1806); tous les jours pairs de la décade. Pendant l'épisode de la Terreur, de 1793 (an II) à 1794 (an III), Blouet est enfermé dans l’abbaye Saint Vincent, mais la publication du journal n’est pas interrompue pour autant, car Claude Lamort (1758-1828) se charge de l’impression jusqu’en 1794. Grâce à quelques appuis politiques, Blouet est libéré et le journal prospère. En 1793 an II, Blouet organise le changement de calendrier du journal. L'édition 43 du 24 octobre 1793 devient datée "Du 3e jour de la 1ere décade du 2d. mois de l’an II de la république". Le numéro 1 de l'année suivante 1794 débute le 25 décembre 1793 "Du 5e jour du mois Nivôse de l’an III de la république". La parution 51 a lieu le 18 décembre 1794. Mais le nouveau calendrier s'avère peu fonctionnel pour le Journal et dès 1795, calendrier républicain et traditionnels sont mentionnés côte à côte. Le n°1 de l'an IV paraît le 26 septembre 1795. Les imprimeurs sont successivement Claude Lamort, puis Verronnais en l'an IV (1795-1796). En 1797 (an V), Blouet crée sa propre imprimerie en Chandellerue à Metz. Le 24 février 1801 le journal fusionne avec "L’Abeille des Gazettes et journaux des départemens de la République et des pays étrangers" pour régler les problèmes financiers que connaissent les deux rédactions. En 1802, le "Journal de Metz (1799-1802)" de Verronnais est absorbé. En 1806 le journal change de nouveau de nom pour mieux représenter son lectorat cible : il devient le "Journal du département de la Moselle". La politique éditoriale par contre change peu. Parmi les nouvelles politiques, la fuite du roi et son arrestation à Varennes (du 20 au 25 juin 1791) est relatée dans le numéro du 28 juin des Annales nationales et politiques. "Assemblée Nationale. Séance du 21 juin. M. le président a annoncé la fuite ou l’enlèvement du roi et de sa famille". Une autre annonce parue le 20 octobre 1791 "Éducation Nationale. La municipalité vient d'établir en cette ville, à commencer du 2 novembre prochain, 13 cours d'enseignemens publics et gratuits. Savoir: 1°. de langue françoise; 2°. de langue allemande; 3°. de langue latine, divisée en trois classes, élémens, traduction, composition, sous trois professeurs seulement; 4°. de belles-lettres françoises ; 5°., de belles- lettres latines; 6°; de logique françoise; 7°. de logique latine; 8°. d'histoire et de géographie, ancienne et moderne; 9°., de physique; 10°, de mathématiques; 11°. d'histoire naturelle; 12°. d’élémens du commerces 13°. enfin, de morale et de droit public. Tous les jeunes citoyens, tant du dedans que du dehors, s’empresseront sans doute de profiter des avantages de cet établissement, unique dans la circonstance". Le numéro du 5 octobre 1796 (14 Vendém an 5 (N°. 3.) mentionne : "L'examen des candidats pour l’école polytechnique, s'ouvrira à la maison commune de Metz, le premier brumaire prochain , huit heures du matin, par le citoyen Lebrun, nommé examinateur, et en présence des Commissaires nommés par l'Administration municipale, il continuera tous les jours, depuis 8 heures du matin jusqu'à midi, et de 2 à 6 heures du soir, et sera définitivement clos le 10". année; numéros; pages par année; titre principal; imprimeur; format 1790; 52; 416; Journal des départements de la Moselle, de la Meurthe, de la Meuse, des Ardennes et des Vosges; Claude Lamort; 8 pages 1789-1806; 192; 372; Annales Nationales et Politiques; Claude Lamort; 4 pages 1791; 52; 416; Journal des départements de la Moselle, de la Meurthe, de la Meuse, des Ardennes et des Vosges; Claude Lamort; 8 pages 1792; 52; 414; Journal des départements de la Moselle, de la Meurthe, de la Meuse, des Ardennes et des Vosges; Claude Lamort; 8 pages 1793; 52; 418; Journal des départements de la Moselle, de la Meurthe, de la Meuse, des Ardennes et des Vosges; Claude Lamort; 8 pages 1794 (an III); 51; 410; Journal des départements de la Moselle, de la Meurthe, de la Meuse, des Ardennes et des Vosges; Claude Lamort; 8 pages 1795/09/26-1796/09/20 (an IV); 72; 584; Journal des départements de la Moselle, de la Meurthe, de la Meuse, des Ardennes et des Vosges; Verronnais Imprimeur place de la Loi; 8 pages 1796/09/27-1797/09/27 (an V); 162; 743; Journal des départements de la Moselle, de la Meurthe, etc ; Blouet Imprimeur; 4 pages 1797/09/23-1798/08/17 (an VI); 165; ?; Journal des départements de la Moselle, de la Meurthe, etc ; Blouet Imprimeur; 4 pages En matière de numérisation, le périodique est disponible de manière partielle à la BnF et de manière intégrale sur Limedia, bibliothèque de Metz.
Journal des départements de la Moselle, de la Meurthe, de la Meuse, des Ardennes et des Vosges (1790-1806)Journalisme et journaux en France - Moselle; 1790-1806; Blouet, Jean-François (1745-1809);
Le 15 janvier 1790, l’Assemblée constituante issue de la Révolution française vote la réorganisation du territoire français en 83 départements dont les limites respectent en partie le tracé des anciennes provinces. Prenant acte de cette décision, Blouet renomme les Affiches en "Journal des départements de la Mozelle, de la Meurthe, de la Meuse, des Ardennes et des Vosges". On remarque au passage l'orthographe initiale de la Moselle. Le premier numéro parait le 15 juillet 1790, augmenté du supplément "Annales nationales et politiques", dans lequel les délibérations de l'assemblée nationale paraissent. La périodicité du journal va varier : hebdomadaire; bidécadaire (24 déc. 1794-19 nov. 1796 ; 22 août 1798-1806); tous les jours pairs de la décade. Pendant l'épisode de la Terreur, de 1793 (an II) à 1794 (an III), Blouet est enfermé dans l’abbaye Saint Vincent, mais la publication du journal n’est pas interrompue pour autant, car Claude Lamort (1758-1828) se charge de l’impression jusqu’en 1794. Grâce à quelques appuis politiques, Blouet est libéré et le journal prospère. En 1793 an II, Blouet organise le changement de calendrier du journal. L'édition 43 du 24 octobre 1793 devient datée "Du 3e jour de la 1ere décade du 2d. mois de l’an II de la république". Le numéro 1 de l'année suivante 1794 débute le 25 décembre 1793 "Du 5e jour du mois Nivôse de l’an III de la république". La parution 51 a lieu le 18 décembre 1794. Mais le nouveau calendrier s'avère peu fonctionnel pour le Journal et dès 1795, calendrier républicain et traditionnels sont mentionnés côte à côte. Le n°1 de l'an IV paraît le 26 septembre 1795. Les imprimeurs sont successivement Claude Lamort, puis Verronnais en l'an IV (1795-1796). En 1797 (an V), Blouet crée sa propre imprimerie en Chandellerue à Metz. Le 24 février 1801 le journal fusionne avec "L’Abeille des Gazettes et journaux des départemens de la République et des pays étrangers" pour régler les problèmes financiers que connaissent les deux rédactions. En 1802, le "Journal de Metz (1799-1802)" de Verronnais est absorbé. En 1806 le journal change de nouveau de nom pour mieux représenter son lectorat cible : il devient le "Journal du département de la Moselle". La politique éditoriale par contre change peu. Parmi les nouvelles politiques, la fuite du roi et son arrestation à Varennes (du 20 au 25 juin 1791) est relatée dans le numéro du 28 juin des Annales nationales et politiques. "Assemblée Nationale. Séance du 21 juin. M. le président a annoncé la fuite ou l’enlèvement du roi et de sa famille". Une autre annonce parue le 20 octobre 1791 "Éducation Nationale. La municipalité vient d'établir en cette ville, à commencer du 2 novembre prochain, 13 cours d'enseignemens publics et gratuits. Savoir: 1°. de langue françoise; 2°. de langue allemande; 3°. de langue latine, divisée en trois classes, élémens, traduction, composition, sous trois professeurs seulement; 4°. de belles-lettres françoises ; 5°., de belles- lettres latines; 6°; de logique françoise; 7°. de logique latine; 8°. d'histoire et de géographie, ancienne et moderne; 9°., de physique; 10°, de mathématiques; 11°. d'histoire naturelle; 12°. d’élémens du commerces 13°. enfin, de morale et de droit public. Tous les jeunes citoyens, tant du dedans que du dehors, s’empresseront sans doute de profiter des avantages de cet établissement, unique dans la circonstance". Le numéro du 5 octobre 1796 (14 Vendém an 5 (N°. 3.) mentionne : "L'examen des candidats pour l’école polytechnique, s'ouvrira à la maison commune de Metz, le premier brumaire prochain , huit heures du matin, par le citoyen Lebrun, nommé examinateur, et en présence des Commissaires nommés par l'Administration municipale, il continuera tous les jours, depuis 8 heures du matin jusqu'à midi, et de 2 à 6 heures du soir, et sera définitivement clos le 10". année; numéros; pages par année; titre principal; imprimeur; format 1790; 52; 416; Journal des départements de la Moselle, de la Meurthe, de la Meuse, des Ardennes et des Vosges; Claude Lamort; 8 pages 1789-1806; 192; 372; Annales Nationales et Politiques; Claude Lamort; 4 pages 1791; 52; 416; Journal des départements de la Moselle, de la Meurthe, de la Meuse, des Ardennes et des Vosges; Claude Lamort; 8 pages 1792; 52; 414; Journal des départements de la Moselle, de la Meurthe, de la Meuse, des Ardennes et des Vosges; Claude Lamort; 8 pages 1793; 52; 418; Journal des départements de la Moselle, de la Meurthe, de la Meuse, des Ardennes et des Vosges; Claude Lamort; 8 pages 1794 (an III); 51; 410; Journal des départements de la Moselle, de la Meurthe, de la Meuse, des Ardennes et des Vosges; Claude Lamort; 8 pages 1795/09/26-1796/09/20 (an IV); 72; 584; Journal des départements de la Moselle, de la Meurthe, de la Meuse, des Ardennes et des Vosges; Verronnais Imprimeur place de la Loi; 8 pages 1796/09/27-1797/09/27 (an V); 162; 743; Journal des départements de la Moselle, de la Meurthe, etc ; Blouet Imprimeur; 4 pages 1797/09/23-1798/08/17 (an VI); 165; ?; Journal des départements de la Moselle, de la Meurthe, etc ; Blouet Imprimeur; 4 pages En matière de numérisation, le périodique est disponible de manière partielle à la BnF et de manière intégrale sur Limedia, bibliothèque de Metz. -
Convention nationale. Décrets prononcés (1793-1795)Périodiques officiels; 1793-1795; Convention nationale;
-
Almanach national de France (1793-1803)Annuaires; 1793-1803;Annuaire politique publié depuis la Convention (1793) jusqu'au début de l'Empire (1803). Édité à Paris par Testu, successeur de la veuve d'Houry, rue Hautefeuille, n°14. Il commence par un éphéméride de l'année en cours dans lequel figurent les événements astronomiques et religieux. Les députés sont listés par département. Suivent un index des adresses, une liste des Comités de la Convention nationale (n°9. Comité de l'Instruction publique, composé initialement de treize sections). L'annuaire est numérisé par la BnF. Gaspard de Prony dirige les Ponts-et-Chaussées et le Cadastre, contribue à fonder l'École polytechnique. Parmi les ardennais et mosellans, Ferry. École du Génie établie à Mézières, puis à Metz (1794, an II). École d'artillerie établie à Châlons, puis à Metz (1802, an X).
-
Bulletin des lois (1794-1932)Périodiques officiels; 1794-1932;Le Bulletin des lois a été créé par la loi du 14 frimaire an II (4 décembre 1793). La Convention et le Comité de salut public, soucieux de canaliser et de coordonner les actions, se rendirent compte qu'il fallait créer un organe pour informer les administrations, notamment en province, de ce qui se votait à Paris. Un décret du 31 mars 1931 mit fin à son existence le 1er avril. Reflet des régimes politiques qui se succèdent, le Bulletin change plusieurs fois de titre au cours de son existence. Au final, 1498 numéros paraissent en 139 années d'existence. Le bulletin fut adressé de manière régulière à l'ensemble des communes de France. Il constitue une source primaire fiable pour les études historiques sur une variété de sujets, notamment sur l'histoire de l'enseignement.
-
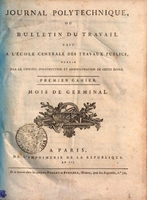 Journal de l'École polytechnique (1794 an III-1938)Périodiques de recherche; 1794-1938;
Publiée par le Conseil d'Instruction de l'école, la revue parait tout d'abord, en 1794 (an III), sous le titre "Journal polytechnique ou Bulletin du travail fait à l'École centrale des travaux publics". Un compte-rendu des législations de la Convention nationale qui ont conduit à la mise en place de l'école est fait. Il est suivi d'un résumé des premiers cours professés à la première année. 1/ Stéréotomie, par Monge (); 2/ Architecture civile et militaire, par Lamblardie, Baltard et Dobenheim; 3/ Dessin, par Neveu; 4/ Analyse appliquée à la mécanique, par Prony; 5/ Physique générale, par Barruel 6/ Chimie avec Fourcroy, Chaptal, Berthollet, Guyton, Vauquelin, Chaussier. Des mémoires complètent l'ensemble. Paru la même année, le deuxième cahier devient intitulé "Journal de l'École polytechnique ou Bulletin du travail fait à cette École". Le nom de l'école a été changé par la loi du 15 fructidor an III (1 septembre 1795). La loi du 30 vendémiaire va fixer le nom de plusieurs écoles d'application pour les élèves. Ceux-ci vont pouvoir choisir en spécialisation l'artillerie, le génie militaire, les ponts et chaussées, les mines, les opérations topographiques ou la construction des vaisseaux. La nourriture et l'habillement des élèves sont assurés. Les cours de la deuxième année sont alors 1/ Suite de l'analyse, par Prony; 2/ Fortification, par Say; 3/ Stéréotomie, par Eisenman; 4/ Dessin, par Neveu; 5/ Architecture, par Griffet-Labaume; 6/ Physique générale, par Barruel; 7/ Sur les lignes de courbure de la surface de l'ellipsoïde, par Monge, avec deux planches; 8/ Chimie par Guyton, Vauquelin, Chaussier; 9/ Cours élémentaire d'analyse de Lagrange, par Prony. Un mémoire sur les lois de la dilatabilité des fluides élastiques complète le tout. La rédaction précise : "Les instituteurs, les agens de l’École , les élèves, sont invités à fournir des mémoires sur les sciences et les ars, soit qu’il s’agisse de travail fait dans l’établissement, soit de recherches tirées d’ailleurs. Les mémoires de même genre qui seraient adressés par des savans en correspondance avec l’École, seraient également accueillis". Des numéros thématiques deviennent aussi publiés. Parmi les personnalités en relation avec le corpus MathsInMetz, sont notamment cités par le journal Charles Gardeur Lebrun, Charles Dupin, Français, Ensheim, Savart père, Poncelet, le libraire Warion, Boileau, Théodore Olivier. En 1895, la revue fête son centenaire. Soixante-quatre cahiers sont déjà publiés et les rédacteurs, font paraitre un index général et rétrospectif, dont le classement est fondé sur celui publié par le Répertoire Bibliographique des Sciences Mathématique (RBSM), mis au point par un groupe international de mathématiciens et de bibliothécaires. Publié de 1894 à 1912, sous la présidence de Poincaré, le répertoire référence ainsi 298 articles en provenance du JEP, classés à l'aide du code RBSM.
Journal de l'École polytechnique (1794 an III-1938)Périodiques de recherche; 1794-1938;
Publiée par le Conseil d'Instruction de l'école, la revue parait tout d'abord, en 1794 (an III), sous le titre "Journal polytechnique ou Bulletin du travail fait à l'École centrale des travaux publics". Un compte-rendu des législations de la Convention nationale qui ont conduit à la mise en place de l'école est fait. Il est suivi d'un résumé des premiers cours professés à la première année. 1/ Stéréotomie, par Monge (); 2/ Architecture civile et militaire, par Lamblardie, Baltard et Dobenheim; 3/ Dessin, par Neveu; 4/ Analyse appliquée à la mécanique, par Prony; 5/ Physique générale, par Barruel 6/ Chimie avec Fourcroy, Chaptal, Berthollet, Guyton, Vauquelin, Chaussier. Des mémoires complètent l'ensemble. Paru la même année, le deuxième cahier devient intitulé "Journal de l'École polytechnique ou Bulletin du travail fait à cette École". Le nom de l'école a été changé par la loi du 15 fructidor an III (1 septembre 1795). La loi du 30 vendémiaire va fixer le nom de plusieurs écoles d'application pour les élèves. Ceux-ci vont pouvoir choisir en spécialisation l'artillerie, le génie militaire, les ponts et chaussées, les mines, les opérations topographiques ou la construction des vaisseaux. La nourriture et l'habillement des élèves sont assurés. Les cours de la deuxième année sont alors 1/ Suite de l'analyse, par Prony; 2/ Fortification, par Say; 3/ Stéréotomie, par Eisenman; 4/ Dessin, par Neveu; 5/ Architecture, par Griffet-Labaume; 6/ Physique générale, par Barruel; 7/ Sur les lignes de courbure de la surface de l'ellipsoïde, par Monge, avec deux planches; 8/ Chimie par Guyton, Vauquelin, Chaussier; 9/ Cours élémentaire d'analyse de Lagrange, par Prony. Un mémoire sur les lois de la dilatabilité des fluides élastiques complète le tout. La rédaction précise : "Les instituteurs, les agens de l’École , les élèves, sont invités à fournir des mémoires sur les sciences et les ars, soit qu’il s’agisse de travail fait dans l’établissement, soit de recherches tirées d’ailleurs. Les mémoires de même genre qui seraient adressés par des savans en correspondance avec l’École, seraient également accueillis". Des numéros thématiques deviennent aussi publiés. Parmi les personnalités en relation avec le corpus MathsInMetz, sont notamment cités par le journal Charles Gardeur Lebrun, Charles Dupin, Français, Ensheim, Savart père, Poncelet, le libraire Warion, Boileau, Théodore Olivier. En 1895, la revue fête son centenaire. Soixante-quatre cahiers sont déjà publiés et les rédacteurs, font paraitre un index général et rétrospectif, dont le classement est fondé sur celui publié par le Répertoire Bibliographique des Sciences Mathématique (RBSM), mis au point par un groupe international de mathématiciens et de bibliothécaires. Publié de 1894 à 1912, sous la présidence de Poincaré, le répertoire référence ainsi 298 articles en provenance du JEP, classés à l'aide du code RBSM. -
Circulaires et instructions officielles relatives à l'instruction publique (1802-1894)Périodiques officiels; 1802-1894;Les Circulaires et instructions rassemblent les instructions adressées par les successifs ministres de l'enseignement à une variété d'acteurs : préfets, recteurs, autorités religieuses, etc. Douze volumes sont ainsi successivement publiés de 1863 à 1902. Les volumes suivants sont successivement publiés et numériquement accessibles : - Tome premier. Années 1802-1830, 1863 - Tome deuxième. Années 1831-1839, 1865 - Tome troisième. Années 1839-1850, 1865 - Tome quatrième. Années 1850-1855, 1866 - Tome cinquième. Années 1856-1863, 1867 - Tome sixième. Années 1863-1869, 1870 - Tome septième. 25 Janvier 1870 - 28 Février 1878, 1878 - Tome huitième. 11 Mars 1878- 28 Mars 1882, 1887 - Tome neuvième. 29 Mars 1882 - 26 Octobre 1886, 1889 - Tome dixième. 3 Novembre 1886 - 31 Mai 1889, 1889 - Tome onzième. Juin 1889 - Décembre 1893, 1894 - Tome douzième. Années 1894-1900, 1902
-
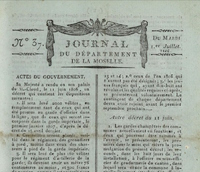 Journal du département de la Moselle (1806-1830)Journalisme et journaux en France - Moselle; 1806-1830; Blouet, Jean-François (1745-1809); Collignon, Christophe-Gabriel (1763-1826); Jaubert, Louis de (1764-1823); Dubalay, Jean (1789-?);
Le Journal du département débute sa parution en 1806. Il fait suite au "Journal des départements de la Moselle, de la Meurthe, de la Meuse, des Ardennes et des Vosges" et paraît tous les quatre jours, six fois par mois. Le contenu éditorial est fait d'annonces (ventes, locations…), de nouvelles de toute la France, culturelles, judiciaires et scientifiques, ainsi que des chroniques politiques. Il rapporte par exemple en détail le siège de Metz de 1814, qui opposa les forces françaises du général Durutte aux troupes coalisées dirigées par le général russe Dimitri Mikhaïlovitch Iouzefovitch. Le 3 août 1809, le fondateur du journal Jean-François-Nicolas Blouet décède et l'imprimeur Louis Verronnais (1762-1812) tente de récupérer le titre, mais les autorités le lui refusent. Le 25 septembre 1809, Christophe-Gabriel Collignon (1763-1826), fils d'imprimeur messin, prend les rênes de la publication, pour quelques semaines seulement. Claude Lamort devient finalement propriétaire du journal le 20 octobre de la même année. Ce dernier était bien connu de Blouet car il avait assuré l’impression de son précédent titre, lorsque Blouet était « cloîtré » dans l’abbaye Saint-Vincent, au cours des épisodes violents de la Terreur (1794). En 1810, le comte Louis de Jaubert (1764-1823), bibliothécaire, prend la suite de Lamort pour rester à la tête du Journal du département jusqu’en 1819. Puis Jean Dubalay assure la succession en qualité de propriétaire rédacteur jusqu’à la fin de l’année 1830. Le périodique se trouve numérisé sur Limédia, de 1806 à 1810, et pour une sélection de numéros ultérieurs sur Gallica.
Journal du département de la Moselle (1806-1830)Journalisme et journaux en France - Moselle; 1806-1830; Blouet, Jean-François (1745-1809); Collignon, Christophe-Gabriel (1763-1826); Jaubert, Louis de (1764-1823); Dubalay, Jean (1789-?);
Le Journal du département débute sa parution en 1806. Il fait suite au "Journal des départements de la Moselle, de la Meurthe, de la Meuse, des Ardennes et des Vosges" et paraît tous les quatre jours, six fois par mois. Le contenu éditorial est fait d'annonces (ventes, locations…), de nouvelles de toute la France, culturelles, judiciaires et scientifiques, ainsi que des chroniques politiques. Il rapporte par exemple en détail le siège de Metz de 1814, qui opposa les forces françaises du général Durutte aux troupes coalisées dirigées par le général russe Dimitri Mikhaïlovitch Iouzefovitch. Le 3 août 1809, le fondateur du journal Jean-François-Nicolas Blouet décède et l'imprimeur Louis Verronnais (1762-1812) tente de récupérer le titre, mais les autorités le lui refusent. Le 25 septembre 1809, Christophe-Gabriel Collignon (1763-1826), fils d'imprimeur messin, prend les rênes de la publication, pour quelques semaines seulement. Claude Lamort devient finalement propriétaire du journal le 20 octobre de la même année. Ce dernier était bien connu de Blouet car il avait assuré l’impression de son précédent titre, lorsque Blouet était « cloîtré » dans l’abbaye Saint-Vincent, au cours des épisodes violents de la Terreur (1794). En 1810, le comte Louis de Jaubert (1764-1823), bibliothécaire, prend la suite de Lamort pour rester à la tête du Journal du département jusqu’en 1819. Puis Jean Dubalay assure la succession en qualité de propriétaire rédacteur jusqu’à la fin de l’année 1830. Le périodique se trouve numérisé sur Limédia, de 1806 à 1810, et pour une sélection de numéros ultérieurs sur Gallica. -
Almanach impérial, pour l'année (1809-1813)Annuaires; 1809-1813;Almanach impérial, pour l'année .... présenté à Sa Majesté l'Empereur par Testu
-
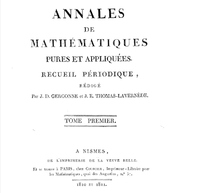 Annales de mathématiques pures et appliquées (1810-1832)Périodiques de recherche; 1810-1832; Gergonne, Joseph Diez (1771-1859); Thomas de Lavernède, Joseph Esprit (1766-1848);
L'histoire du journal se montre étroitement liée à celle de son fondateur Joseph-Diez Gergonne (1771-1859), dont la biographie peut être brièvement retracée. Gergonne nait à Nancy le 19 juin 1771. Il est le fils d'André Gergonne, peintre et architecte à la cour du duc de Lorrraine, et de Louise-Thérèse Masso. Suite à ses études menées au collège survient la Révolution. De 1789 à 1791, il devient répétiteur de mathématiques au collège de Nancy. Engagé volontaire à la fin de l’été 1792, il est envoyé à Sarrelouis, vers la frontière et participe à la bataille de Valmy qui voit la France défaire l’Autriche et la Prusse. Un oncle, juge à Paris, lui propose un travail de secrétaire. Mais Gergonne est bientôt appelé de nouveau dans les rangs de l’armée et envoyé avec son bataillon parisien à la frontière, puis au 47e Régiment d'infanterie de Lorraine ou il devient nommé secrétaire de l’état-major. Face à la pénurie d’officiers instruits, les soldats qui avaient des connaissances étaient invités à se présenter aux examens d’admission de l’École d’artillerie de Châlons-sur-Marne. Lacroix est examinateur et l'entretien public se prolonge durant 4 heures, au bout desquelles Gergonne gagne le grade de lieutenant et devient admis à l'école. En 1794 (année de création de polytechnique), il participe à la campagne d’Espagne puis revient ensuite à la vie civile, en 1795. En mars 1796, Il obtient sur concours une chaire de mathématiques à l’École centrale de Nîmes. En 1803, Gergonne épouse Eugénie Leclair. Il est nommé professeur de "mathématiques transcendantes" au lycée de Nîmes en 1804. Il enseigne notamment la géométrie, la trigonométrie, l'algèbre, l'analyse. Suite à de nombreux échanges effectués avec plusieurs correspondants, à partir de juillet 1810, le journal de Gergonne parait. Une livraison de 4 feuilles (32 pages) a lieu le premier de chaque mois. Les notes relatives à la rédaction, les mémoires à insérer, ouvrages à annoncer et demandes d'abonnement, peuvent être adressés au rédacteur, essentiellement Gergonne, 130 rue d'Avignon à Nîmes et chez ses successifs éditeurs, ou bien chez Courcier, libraire pour les mathématiques, 57 quai des Augustins à Paris. Charge à l'acheteur de relier les publication en un volume annuel. Gergonne grave lui-même les plaques de cuivre des figures des articles, problèmes et solutions. De 1810 à 1832, plusieurs membres de la famille Courcier se succèdent à l'édition à Paris : Louis Courcier, Veuve Courcier, M. Bachelier gendre Courcier, tous spécialistes de l'impression de journaux mathématiques. La revue fournit un avis aux relieurs. En 1816, Gergonne est nommé professeur à la chaire d’astronomie de la faculté de Montpellier. Peu après la Révolution de 1830, Gergonne devient Recteur de l’Académie de Montpellier, sans toutefois cesser ses enseignements en lycée et faculté. Fin 1831, cette surcharge d’activité occasionnée par une fonction supplémentaire le conduit à cesser les parutions. Dans le premier numéro de 1810, parmi les références, la rédaction signale "Le journal de l'école polytechnique" et "La correspondance de M. Hachette". Thomas de Lavernède s'implique deux années dans l'édition de la revue, puis Gergonne poursuit seul. Plusieurs mathématiciens messins d'origine ou d'adoption y publient des articles, parmi lesquels Poncelet, Terquem, auteur lui-même d'un autre journal à destination des élèves et professeurs, à partir de 1842. Les Annales se trouvent de nos jours intégralement numérisées dans Numdam, partiellement transcrites dans Wikisource. Publié par Liouville et ses successeurs de 1836 à 1945, le "Journal de mathématiques pures et appliquées" est souvent considéré comme une suite de la publication nîmoise. A partir de 1830, l'offre en journaux mathématiques va grandement s'élargir.
Annales de mathématiques pures et appliquées (1810-1832)Périodiques de recherche; 1810-1832; Gergonne, Joseph Diez (1771-1859); Thomas de Lavernède, Joseph Esprit (1766-1848);
L'histoire du journal se montre étroitement liée à celle de son fondateur Joseph-Diez Gergonne (1771-1859), dont la biographie peut être brièvement retracée. Gergonne nait à Nancy le 19 juin 1771. Il est le fils d'André Gergonne, peintre et architecte à la cour du duc de Lorrraine, et de Louise-Thérèse Masso. Suite à ses études menées au collège survient la Révolution. De 1789 à 1791, il devient répétiteur de mathématiques au collège de Nancy. Engagé volontaire à la fin de l’été 1792, il est envoyé à Sarrelouis, vers la frontière et participe à la bataille de Valmy qui voit la France défaire l’Autriche et la Prusse. Un oncle, juge à Paris, lui propose un travail de secrétaire. Mais Gergonne est bientôt appelé de nouveau dans les rangs de l’armée et envoyé avec son bataillon parisien à la frontière, puis au 47e Régiment d'infanterie de Lorraine ou il devient nommé secrétaire de l’état-major. Face à la pénurie d’officiers instruits, les soldats qui avaient des connaissances étaient invités à se présenter aux examens d’admission de l’École d’artillerie de Châlons-sur-Marne. Lacroix est examinateur et l'entretien public se prolonge durant 4 heures, au bout desquelles Gergonne gagne le grade de lieutenant et devient admis à l'école. En 1794 (année de création de polytechnique), il participe à la campagne d’Espagne puis revient ensuite à la vie civile, en 1795. En mars 1796, Il obtient sur concours une chaire de mathématiques à l’École centrale de Nîmes. En 1803, Gergonne épouse Eugénie Leclair. Il est nommé professeur de "mathématiques transcendantes" au lycée de Nîmes en 1804. Il enseigne notamment la géométrie, la trigonométrie, l'algèbre, l'analyse. Suite à de nombreux échanges effectués avec plusieurs correspondants, à partir de juillet 1810, le journal de Gergonne parait. Une livraison de 4 feuilles (32 pages) a lieu le premier de chaque mois. Les notes relatives à la rédaction, les mémoires à insérer, ouvrages à annoncer et demandes d'abonnement, peuvent être adressés au rédacteur, essentiellement Gergonne, 130 rue d'Avignon à Nîmes et chez ses successifs éditeurs, ou bien chez Courcier, libraire pour les mathématiques, 57 quai des Augustins à Paris. Charge à l'acheteur de relier les publication en un volume annuel. Gergonne grave lui-même les plaques de cuivre des figures des articles, problèmes et solutions. De 1810 à 1832, plusieurs membres de la famille Courcier se succèdent à l'édition à Paris : Louis Courcier, Veuve Courcier, M. Bachelier gendre Courcier, tous spécialistes de l'impression de journaux mathématiques. La revue fournit un avis aux relieurs. En 1816, Gergonne est nommé professeur à la chaire d’astronomie de la faculté de Montpellier. Peu après la Révolution de 1830, Gergonne devient Recteur de l’Académie de Montpellier, sans toutefois cesser ses enseignements en lycée et faculté. Fin 1831, cette surcharge d’activité occasionnée par une fonction supplémentaire le conduit à cesser les parutions. Dans le premier numéro de 1810, parmi les références, la rédaction signale "Le journal de l'école polytechnique" et "La correspondance de M. Hachette". Thomas de Lavernède s'implique deux années dans l'édition de la revue, puis Gergonne poursuit seul. Plusieurs mathématiciens messins d'origine ou d'adoption y publient des articles, parmi lesquels Poncelet, Terquem, auteur lui-même d'un autre journal à destination des élèves et professeurs, à partir de 1842. Les Annales se trouvent de nos jours intégralement numérisées dans Numdam, partiellement transcrites dans Wikisource. Publié par Liouville et ses successeurs de 1836 à 1945, le "Journal de mathématiques pures et appliquées" est souvent considéré comme une suite de la publication nîmoise. A partir de 1830, l'offre en journaux mathématiques va grandement s'élargir. -
Annuaire royal, pour l'an (1814-1830)Annuaires; 1814-1830;L'almanach pour les années 1814 et 1815 serait publié fin 1814, d'après l'avis des éditeurs ; il est annoncé à la "Bibliographie de la France" du 4 février 1815, art. 337. - Tous les volumes reproduisent à la fin les lettres patentes du 22 juin 1814, délivrées conjointement au sieur Testu et aux sieur et dame Guyot, leur permettant de faire imprimer l'Almanach royal pendant 20 ans.
-
Journal d'éducation (1815-1828)Périodiques de recherche; 1815-1828; Société pour l'instruction élémentaire (1815-);Publié dès 1815 par la Société formée à Paris pour l'amélioration de l'enseignement élémentaire, le Journal d'éducation vise à promouvoir une diffusion de l'enseignement primaire sur l'ensemble du territoire. La méthode d'enseignement mutuel, dite méthode de Lancastre devient promue lors de la Restauration, activement soutenue par les préfectures et municipalités. En 1829, le journal est renommé "Bulletin de la Société pour l'instruction élémentaire" et il reste publié jusqu'en 1841. De 1842 à 1927, il est nommé "Journal d'éducation populaire". Le journal se trouve numérisé sur Gallica.
-
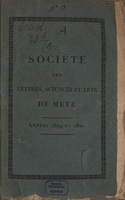 Mémoires de l'Académie nationale de Metz (1819-)Périodiques de recherche; 1819-2020; Académie nationale de Metz (1757-1793, 1819-);
Le premier numéro des Mémoires de l'Académie de Metz parait en juillet 1821, sous le titre "Société des Lettres, Sciences et Arts de Metz. Année 1819 et 1820. Séance générale du 15 avril 1821". Plusieurs changements de titre suivront, mais l'objet de la revue reste le même : relater les délibérations et travaux effectués par l'académie pendant l'année universitaire en cours. Lors de la séance publique du 15 avril, Pierre-Christophe Gorcy (1758-1826), médecin en chef d'armée et premier professeur à l'hôpital militaire d'instruction de Metz, président de l'académie, prononce le discours d'ouverture. Puis le secrétaire Jean-Charles Herpin (1798-1872), rentier et membre de plusieurs sociétés savantes, poursuit. Il présente en deux parties, d'une part les sciences, d'autre part les lettres (littérature, géographie, histoire, archéologie, beaux-arts). Dans la première partie, un compte-rendu du cours de Jean-Nicolas Noël (1783-1867) est fait. Noël vient en effet de publier à Metz chez Lamort son "Traité d'Algèbre élémentaire, raisonnée et appliquée". Puis suit un compte-rendu d'un mémoire fait par le polytechnicien Olivier sur le lavis des ombres dans les dessins. Les ombrés sont en effet utilisés dans les cartes et dessins industriels pour figurer les reliefs. Les travaux de Poncelet portant sur le géométrie projective et le principe de continuité sont relatés, de même que ceux de Savart sur la fabrication d'instruments de précision utilisés en topographie. On s'occupe encore d'électricité, de chimie, d'économie, de médecine et d'agriculture. Les premiers travaux se montrent multidisciplinaires, orientés vers les sciences appliquées. Plusieurs académies généralistes de ce type se trouvent refondées sur le quart Nord-Est de la France. Leurs activités s'inscrivent dans la continuité des académies royales dissoutes en 1793. Ainsi, l'Académie de Nancy publie dès 1805 son "Précis des travaux de la Société des sciences, lettres et arts de Nancy" (1805-1829). L'Académie de Dijon publie en 1810 "Séance publique de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres" de Dijon. Metz entre en jeu de manière un peu plus tardive. La Société industrielle de Mulhouse est fondée en 1826. Dans ces académies locales, il s'agit de rendre compte de manière solennelle des travaux et sujets débattus dans une variété de domaines scientifiques. Des séances, questions soumises à récompenses, des expositions apportent une émulation. Les sujets politiques se montrent en théorie proscrits. Les questions de l'enseignement en général, celui des mathématiques en particulier, celui des écoles et différentes techniques pédagogiques mises en œuvre se montrent bien traitées, particulièrement à Metz dans laquelle plusieurs communautés religieuses voisinent et qui accueille, postérieurement à 1802, l'École d'application de l'artillerie et du génie ainsi que d'autres écoles militaires. Quelques deux cents ans plus tard, à partir de 2007, les premiers volumes numérisés, référencés à titre du dépôt légal, deviennent disponibles sur Gallica. Actuellement, les volumes des années 1819 à 2020 se montrent accessibles. Google Livres, de même qu'Internet Archive donnent également accès à un grand nombre de volumes numérisés. Cependant, l'exploration des contenus ne se fait pas sans quelques difficultés. Le documentaliste ou l'historien souhaiterait disposer d'une seule notice et d'un seul moteur de recherche pour accéder à l'ensemble des documents produits par l'académie. Une première difficulté provient de la revue elle-même et de ses subdivisions. Les titres, numérotations et parfois langues d'écriture, ont changé au cours de l'histoire de cette publication. À la BnF, les volumes se trouvent catalogués en plusieurs notices bibliographiques. La bibliothèque nationale distingue les parutions de 1819 à 1827, de celles parues 1827 à 2020. Certains volumes de la BnF sont numérisés, mais non OCRisés et la recherche d'années particulières passe alors par l'étude du sommaire. L'Académie a par ailleurs créé des volumes particulièrement intéressants, qui sont les tables des matières et index des articles de diverses périodes 1819-1871 [1873]; 1819-1895; 1819-1903 [1908]; 1904-1930; 1931-1961. L'exploration de Google Livres présente ses propres difficultés. Le catalogage se montre en effet absent et de multiples exemplaires identiques, en provenance de bibliothèques différentes, sont accessibles. La base Internet Archive se montre intéressante, car les ouvrages numérisés par Google à la demande de plusieurs bibliothèques s'y trouvent catalogués. L'ergonomie de la visionneuse se montre plaisante. Pour répondre à la question d'un accès rapide aux Mémoires, des membres des Archives Henri Poincaré ont créé deux documents HTML. Ils rassemble les liens vers les livres numériques présents dans Gallica, Google Livres et Internet Archive. Le premier fichier concerne la période 1809-1871, le second la période 1871-2020. Bonne exploration des Mémoires de l'Académie !
Mémoires de l'Académie nationale de Metz (1819-)Périodiques de recherche; 1819-2020; Académie nationale de Metz (1757-1793, 1819-);
Le premier numéro des Mémoires de l'Académie de Metz parait en juillet 1821, sous le titre "Société des Lettres, Sciences et Arts de Metz. Année 1819 et 1820. Séance générale du 15 avril 1821". Plusieurs changements de titre suivront, mais l'objet de la revue reste le même : relater les délibérations et travaux effectués par l'académie pendant l'année universitaire en cours. Lors de la séance publique du 15 avril, Pierre-Christophe Gorcy (1758-1826), médecin en chef d'armée et premier professeur à l'hôpital militaire d'instruction de Metz, président de l'académie, prononce le discours d'ouverture. Puis le secrétaire Jean-Charles Herpin (1798-1872), rentier et membre de plusieurs sociétés savantes, poursuit. Il présente en deux parties, d'une part les sciences, d'autre part les lettres (littérature, géographie, histoire, archéologie, beaux-arts). Dans la première partie, un compte-rendu du cours de Jean-Nicolas Noël (1783-1867) est fait. Noël vient en effet de publier à Metz chez Lamort son "Traité d'Algèbre élémentaire, raisonnée et appliquée". Puis suit un compte-rendu d'un mémoire fait par le polytechnicien Olivier sur le lavis des ombres dans les dessins. Les ombrés sont en effet utilisés dans les cartes et dessins industriels pour figurer les reliefs. Les travaux de Poncelet portant sur le géométrie projective et le principe de continuité sont relatés, de même que ceux de Savart sur la fabrication d'instruments de précision utilisés en topographie. On s'occupe encore d'électricité, de chimie, d'économie, de médecine et d'agriculture. Les premiers travaux se montrent multidisciplinaires, orientés vers les sciences appliquées. Plusieurs académies généralistes de ce type se trouvent refondées sur le quart Nord-Est de la France. Leurs activités s'inscrivent dans la continuité des académies royales dissoutes en 1793. Ainsi, l'Académie de Nancy publie dès 1805 son "Précis des travaux de la Société des sciences, lettres et arts de Nancy" (1805-1829). L'Académie de Dijon publie en 1810 "Séance publique de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres" de Dijon. Metz entre en jeu de manière un peu plus tardive. La Société industrielle de Mulhouse est fondée en 1826. Dans ces académies locales, il s'agit de rendre compte de manière solennelle des travaux et sujets débattus dans une variété de domaines scientifiques. Des séances, questions soumises à récompenses, des expositions apportent une émulation. Les sujets politiques se montrent en théorie proscrits. Les questions de l'enseignement en général, celui des mathématiques en particulier, celui des écoles et différentes techniques pédagogiques mises en œuvre se montrent bien traitées, particulièrement à Metz dans laquelle plusieurs communautés religieuses voisinent et qui accueille, postérieurement à 1802, l'École d'application de l'artillerie et du génie ainsi que d'autres écoles militaires. Quelques deux cents ans plus tard, à partir de 2007, les premiers volumes numérisés, référencés à titre du dépôt légal, deviennent disponibles sur Gallica. Actuellement, les volumes des années 1819 à 2020 se montrent accessibles. Google Livres, de même qu'Internet Archive donnent également accès à un grand nombre de volumes numérisés. Cependant, l'exploration des contenus ne se fait pas sans quelques difficultés. Le documentaliste ou l'historien souhaiterait disposer d'une seule notice et d'un seul moteur de recherche pour accéder à l'ensemble des documents produits par l'académie. Une première difficulté provient de la revue elle-même et de ses subdivisions. Les titres, numérotations et parfois langues d'écriture, ont changé au cours de l'histoire de cette publication. À la BnF, les volumes se trouvent catalogués en plusieurs notices bibliographiques. La bibliothèque nationale distingue les parutions de 1819 à 1827, de celles parues 1827 à 2020. Certains volumes de la BnF sont numérisés, mais non OCRisés et la recherche d'années particulières passe alors par l'étude du sommaire. L'Académie a par ailleurs créé des volumes particulièrement intéressants, qui sont les tables des matières et index des articles de diverses périodes 1819-1871 [1873]; 1819-1895; 1819-1903 [1908]; 1904-1930; 1931-1961. L'exploration de Google Livres présente ses propres difficultés. Le catalogage se montre en effet absent et de multiples exemplaires identiques, en provenance de bibliothèques différentes, sont accessibles. La base Internet Archive se montre intéressante, car les ouvrages numérisés par Google à la demande de plusieurs bibliothèques s'y trouvent catalogués. L'ergonomie de la visionneuse se montre plaisante. Pour répondre à la question d'un accès rapide aux Mémoires, des membres des Archives Henri Poincaré ont créé deux documents HTML. Ils rassemble les liens vers les livres numériques présents dans Gallica, Google Livres et Internet Archive. Le premier fichier concerne la période 1809-1871, le second la période 1871-2020. Bonne exploration des Mémoires de l'Académie ! -
 Bulletin général et universel des annonces et des nouvelles scientifiques (1823), puis Bulletin universel des sciences et de l'industrie (1824-1831)Répertoires bibliographiques; Périodiques de recherche; 1823; 1824-1831;
Bulletin général et universel des annonces et des nouvelles scientifiques (1823), puis Bulletin universel des sciences et de l'industrie (1824-1831)Répertoires bibliographiques; Périodiques de recherche; 1823; 1824-1831; 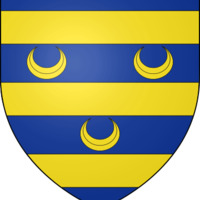 Férussac, André-Étienne d'Audebard (1786-1836; baron de);
En 1822, parait le prospectus d'un nouveau titre à paraitre : "Bulletin général et universel des annonces et des nouvelles scientifiques, dédié aux savants de tous les pays et à la librairie nationale et étrangère", publié à Paris chez J. Didot, sous la direction de M. le baron de Férussac. On y trouve, détaillé en 22 pages, la promesse de parution d'un périodique à l'usage des "savants" et amis des sciences, des bibliothèques, visant à faire connaitre à l'aide d'articles les parutions nouvelles dans une variété de domaines scientifiques. Un plan en trois parties est proposé : 1/ Annonces des ouvrages, 2/ Extraits des journaux, 3/ Nouvelles scientifiques ou extrait des correspondances. Un "tableau synoptique des sciences" (plan de classement) est exposé, repris des matières relevant de l'Académie des sciences de l'Institut de France. Un groupe de "collaborateurs" est nommé, garant de la validité des contenus. Pour les mathématiques pures, on trouve : Hachette (Jean Nicolas Pierre, 1769-1834, auteur de cours, professeur de polytechnique alors politiquement banni, continuateur de Monge), Levilain, Benoit, Alexandre-Louis Billy, (1757-1830, professeur au Collège de Sens, alors retraité et bibliothécaire du Conservatoire national des Arts et Métiers), Hanus, Navié (Navier, Henri ? 1785-1836), Coriolis, Deflers, Berthevin; Pour les mathématiques appliquées : Navié, Fresnel (), Hachette, Coriolis, Hanus, Leblanc, Benoit; en topographie Férussac cite : Lapie, Denaix, Levilain, Benoit; en sciences physiques : Ampère, Fresnel, Pouillet, Babinet; etc. A l'issue de la première année de parution, un groupe en partie différent, constitué de Férussac lui-même et de libraires a assuré le signalement des ouvrages. En mathématiques, les résumés de livres sont signés de Camille Deflers (1794-1824), J. Terquem (parent d'Olry Terquem ?), Jules Berthevin (1769-183 ?), libraires tous les deux. Un dépôt général de bibliographie doit également être organisé. Débute en 1823 la publication du tome I du "Bulletin général et universel des annonces et des nouvelles scientifiques" contient 996 signalements numérotés en 495 pages. Un répertoire bibliographique multidisciplinaire avec classement thématique est publié. Trois parutions par an sont prévues, paginées en continuité, pour constituer, après brochage par un relieur, un tome annuel. Le classement des ouvrages distingue notamment "Mathématiques élémentaires", "Mathématiques transcendantes", "Topographie, Géodésie", "Machines", "Astronomie", "Physique", "Statistique", "Art militaire", "Carte". Ces classes voisinent avec "Histoire naturelle", "Zoologie", "Médecine", "Art vétérinaire". Puis suivent une liste des journaux parus, un résumé des travaux des sociétés savantes parisiennes et provinciales, des nouvelles et annonces scientifiques. Le Bulletin est imprimé à Paris chez Fain, place de l'Odéon. Le tome II parait également en 1823, en deux parties au lieu de trois. La liste des collaborateurs est tout d'abord rappelée. 985 parutions, parmi lesquelles celles du livre de Férussac sont signalées en 499 pages. L'année suivante, en 1824, parait le premier tome d'une publication similaire, imprimée sous un titre différent "Bulletin universel des sciences et de l'industrie". Divisé en huit sections 1/ "Bulletin des sciences mathématiques, astronomiques, physiques et chimiques", 2/ "Bulletin des sciences naturelles et de géologie", 3/ "Bulletin des sciences médicales". Ce projet durera neuf ans et comptera 170 tomes. Il comprend huit sections : mathématiques, histoire naturelle, médecine, agronomie, technologie, géographie, histoire et science militaire. Pour publier son bulletin, Ferrsussac s'entoure d'une équipe de rédacteurs avec, pour les mathématiques. La liste des collaborateurs est extrêmement variée et inclut Olry Terquem, Évariste Galois. ??? Esprit encyclopédique, il eut bientôt l'idée de son Bulletin, avec le projet d'une télégraphie universelle pour la diffusion des connaissances. L'ensemble constitua, sur neuf années, 170 tomes, en plusieurs sections (constituées dès la deuxième année, elle sont au nombre de huit : sciences mathématiques, naturelles, médicales, agricoles, technologiques, géographiques, historiques, militaires) d'un éclectisme absolu : la section "Histoire, Antiquités et Philologie" avait "pour rédacteurs principaux MM. Champollion-Figeac et Champollion jeune" ! " Malheureusement la publication en fut arrêtée quelques années après la révolution de Juillet, parce que les chambres refusèrent d'allouer la somme nécessaire pour soutenir une si vaste entreprise. " La liste des collaborateurs réguliers et des contributeurs comprend les noms les plus prestigieux : Ampère, Billy, Berthevin, Cauchy, Chasles, Coriolis, Dupin, Fourier, Hachette, Lacroix, Le Besgue, Mac-Adam, Montferand, Muller, Navier, Olivier, Poinsot, Poisson, Poncelet, Prony, Servois, Terquem... Et l'on rend aussi large compte des travaux, voyages ou découvertes d'Arago, Avogadro, de Babbage, Becquerel, Belzoni, Berzélius, Biot, Brewster, Colebrooke, Duhamel, Férussac lui-même, Fresnel, Freycinet, Gauss, Gay-Lussac, Gergonne, Ivory, Libri, Ostrogradsky, Plücker, Quételet, Raspail, Ruffini, Saint-Hilaire, Steiner, Zach ... Chaque fascicule est divisé en quatre grands chapitres : mathématiques, astronomie, physique et chimie. A cela s'ajoute une partie de "mélanges" où sont rapportés des comptes-rendus de séances de sociétés savantes (en Europe, mais aussi aux Etats-Unis et en Inde), des notices nécrologiques, des annonces de ventes publiques de bibliothèques scientifiques.
Férussac, André-Étienne d'Audebard (1786-1836; baron de);
En 1822, parait le prospectus d'un nouveau titre à paraitre : "Bulletin général et universel des annonces et des nouvelles scientifiques, dédié aux savants de tous les pays et à la librairie nationale et étrangère", publié à Paris chez J. Didot, sous la direction de M. le baron de Férussac. On y trouve, détaillé en 22 pages, la promesse de parution d'un périodique à l'usage des "savants" et amis des sciences, des bibliothèques, visant à faire connaitre à l'aide d'articles les parutions nouvelles dans une variété de domaines scientifiques. Un plan en trois parties est proposé : 1/ Annonces des ouvrages, 2/ Extraits des journaux, 3/ Nouvelles scientifiques ou extrait des correspondances. Un "tableau synoptique des sciences" (plan de classement) est exposé, repris des matières relevant de l'Académie des sciences de l'Institut de France. Un groupe de "collaborateurs" est nommé, garant de la validité des contenus. Pour les mathématiques pures, on trouve : Hachette (Jean Nicolas Pierre, 1769-1834, auteur de cours, professeur de polytechnique alors politiquement banni, continuateur de Monge), Levilain, Benoit, Alexandre-Louis Billy, (1757-1830, professeur au Collège de Sens, alors retraité et bibliothécaire du Conservatoire national des Arts et Métiers), Hanus, Navié (Navier, Henri ? 1785-1836), Coriolis, Deflers, Berthevin; Pour les mathématiques appliquées : Navié, Fresnel (), Hachette, Coriolis, Hanus, Leblanc, Benoit; en topographie Férussac cite : Lapie, Denaix, Levilain, Benoit; en sciences physiques : Ampère, Fresnel, Pouillet, Babinet; etc. A l'issue de la première année de parution, un groupe en partie différent, constitué de Férussac lui-même et de libraires a assuré le signalement des ouvrages. En mathématiques, les résumés de livres sont signés de Camille Deflers (1794-1824), J. Terquem (parent d'Olry Terquem ?), Jules Berthevin (1769-183 ?), libraires tous les deux. Un dépôt général de bibliographie doit également être organisé. Débute en 1823 la publication du tome I du "Bulletin général et universel des annonces et des nouvelles scientifiques" contient 996 signalements numérotés en 495 pages. Un répertoire bibliographique multidisciplinaire avec classement thématique est publié. Trois parutions par an sont prévues, paginées en continuité, pour constituer, après brochage par un relieur, un tome annuel. Le classement des ouvrages distingue notamment "Mathématiques élémentaires", "Mathématiques transcendantes", "Topographie, Géodésie", "Machines", "Astronomie", "Physique", "Statistique", "Art militaire", "Carte". Ces classes voisinent avec "Histoire naturelle", "Zoologie", "Médecine", "Art vétérinaire". Puis suivent une liste des journaux parus, un résumé des travaux des sociétés savantes parisiennes et provinciales, des nouvelles et annonces scientifiques. Le Bulletin est imprimé à Paris chez Fain, place de l'Odéon. Le tome II parait également en 1823, en deux parties au lieu de trois. La liste des collaborateurs est tout d'abord rappelée. 985 parutions, parmi lesquelles celles du livre de Férussac sont signalées en 499 pages. L'année suivante, en 1824, parait le premier tome d'une publication similaire, imprimée sous un titre différent "Bulletin universel des sciences et de l'industrie". Divisé en huit sections 1/ "Bulletin des sciences mathématiques, astronomiques, physiques et chimiques", 2/ "Bulletin des sciences naturelles et de géologie", 3/ "Bulletin des sciences médicales". Ce projet durera neuf ans et comptera 170 tomes. Il comprend huit sections : mathématiques, histoire naturelle, médecine, agronomie, technologie, géographie, histoire et science militaire. Pour publier son bulletin, Ferrsussac s'entoure d'une équipe de rédacteurs avec, pour les mathématiques. La liste des collaborateurs est extrêmement variée et inclut Olry Terquem, Évariste Galois. ??? Esprit encyclopédique, il eut bientôt l'idée de son Bulletin, avec le projet d'une télégraphie universelle pour la diffusion des connaissances. L'ensemble constitua, sur neuf années, 170 tomes, en plusieurs sections (constituées dès la deuxième année, elle sont au nombre de huit : sciences mathématiques, naturelles, médicales, agricoles, technologiques, géographiques, historiques, militaires) d'un éclectisme absolu : la section "Histoire, Antiquités et Philologie" avait "pour rédacteurs principaux MM. Champollion-Figeac et Champollion jeune" ! " Malheureusement la publication en fut arrêtée quelques années après la révolution de Juillet, parce que les chambres refusèrent d'allouer la somme nécessaire pour soutenir une si vaste entreprise. " La liste des collaborateurs réguliers et des contributeurs comprend les noms les plus prestigieux : Ampère, Billy, Berthevin, Cauchy, Chasles, Coriolis, Dupin, Fourier, Hachette, Lacroix, Le Besgue, Mac-Adam, Montferand, Muller, Navier, Olivier, Poinsot, Poisson, Poncelet, Prony, Servois, Terquem... Et l'on rend aussi large compte des travaux, voyages ou découvertes d'Arago, Avogadro, de Babbage, Becquerel, Belzoni, Berzélius, Biot, Brewster, Colebrooke, Duhamel, Férussac lui-même, Fresnel, Freycinet, Gauss, Gay-Lussac, Gergonne, Ivory, Libri, Ostrogradsky, Plücker, Quételet, Raspail, Ruffini, Saint-Hilaire, Steiner, Zach ... Chaque fascicule est divisé en quatre grands chapitres : mathématiques, astronomie, physique et chimie. A cela s'ajoute une partie de "mélanges" où sont rapportés des comptes-rendus de séances de sociétés savantes (en Europe, mais aussi aux Etats-Unis et en Inde), des notices nécrologiques, des annonces de ventes publiques de bibliothèques scientifiques. -
Expositions industrielles de Metz et de la Moselle (1823, 1826, 1828, 1843, 1849, 1861)Expositions industrielles; 1823; 1826; 1828; 1843; 1849; 1861;Sur le modèle des successives expositions tenues à Paris antérieurement à l'exposition universelle de 1855, plusieurs expositions industrielles se déroulent successivement à Metz, entre 1823 et 1861. Cette dernière édition est d'ailleurs une exposition universelle, à laquelle prennent part divers artisans et industriels. Diverses sections de ces expositions font la part belle aux réalisations et modèles des écoles des arts et métiers, aux fabricants d'instruments de précision (horlogerie, topographie, optique, calculatrices mécaniques, télégraphie) et aux imprimeurs, typographes et photographes, actifs dans les domaines éducatifs et scientifiques.
-
Mémorial de l'artillerie (1824-1867)Périodiques de recherche; 1824-1867;Rédigé par les soins du comité, avec l'approbation du Ministre de la guerre, le périodique parait tous les ans, de 1824 à 1867. Quelques numéros se trouvent numérisés par Google. Tous les ans, des questions sont mises au concours et les mémoires les plus intéressants sont récompensés et publiés. Parmi les lauréats se trouvent Poncelet (1820), Piobert, Morin et Didion (1842). Des règlements sont aussi publiés.
-
 Journal für die reine und angewandte Mathematik (1826-)Périodiques de recherche; 1826;
Le Journal für die reine und angewandte Mathematik / Journal de mathématiques pures et appliquées est fondé à Berlin par August Leopold Crelle (1780-1855) en 1826. Il vient en réponse à la publication des Annales de Mathématiques Pures et Appliquées, créées en 1814 par le professeur et mathématicien né à Nancy Joseph Diez Gergonne (1771-1859). Dans la préface du premier volume, Crelle ne cache pas le réflexe identitaire présidant à la création de son journal : « Comme donc un journal est dans les faits un moyen très efficace pour développer une science et la diffuser, pour la fermer aux influences étrangères, et la protéger des sujétions, des modes, des autorités, des écoles, des respects et de la conserver dans le domaine libre de sa pensée, il vaut la peine d'essayer s'il est possible de donner vie et croissance à une telle publication en langue allemande pour les mathématiques. » [traduit de l'allemand]. Pourtant, dès 1827, le français et le latin, considérés comme langues internationales, deviennent admis. Parmi les premiers promoteurs de publications en français, Louis Olivier, un mathématicien peu connu refusé par Gergonne, le norvégien Niels Henrik Abel (1802-1829), Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet (1805-1859). En 1829, Crelle rédige en français la notice nécrologique d'Abel. En 1829, Crelle établit le classement suivant pour le sommaire : - Reine Mathematik (Mathématiques pure) -- Analysis (Analyse) -- Geometrie (Géométrie) -- Mechanik (Mécanique) - Angewandte Mathematik (Mathématiques appliquées) Poncelet publie dans le Journal de Crelle activement parcouru en 1827 (tracé des engrenages de roues d'angle), 1828 (sur les centres de moyennes harmoniques) et 1835 (sur les séries et développements infinis). Mais à partir de 1836, les mathématiciens français vont privilégier pour leurs publications le Journal de mathématiques pures et appliquées, encore appelé Journal de Liouville.
Journal für die reine und angewandte Mathematik (1826-)Périodiques de recherche; 1826;
Le Journal für die reine und angewandte Mathematik / Journal de mathématiques pures et appliquées est fondé à Berlin par August Leopold Crelle (1780-1855) en 1826. Il vient en réponse à la publication des Annales de Mathématiques Pures et Appliquées, créées en 1814 par le professeur et mathématicien né à Nancy Joseph Diez Gergonne (1771-1859). Dans la préface du premier volume, Crelle ne cache pas le réflexe identitaire présidant à la création de son journal : « Comme donc un journal est dans les faits un moyen très efficace pour développer une science et la diffuser, pour la fermer aux influences étrangères, et la protéger des sujétions, des modes, des autorités, des écoles, des respects et de la conserver dans le domaine libre de sa pensée, il vaut la peine d'essayer s'il est possible de donner vie et croissance à une telle publication en langue allemande pour les mathématiques. » [traduit de l'allemand]. Pourtant, dès 1827, le français et le latin, considérés comme langues internationales, deviennent admis. Parmi les premiers promoteurs de publications en français, Louis Olivier, un mathématicien peu connu refusé par Gergonne, le norvégien Niels Henrik Abel (1802-1829), Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet (1805-1859). En 1829, Crelle rédige en français la notice nécrologique d'Abel. En 1829, Crelle établit le classement suivant pour le sommaire : - Reine Mathematik (Mathématiques pure) -- Analysis (Analyse) -- Geometrie (Géométrie) -- Mechanik (Mécanique) - Angewandte Mathematik (Mathématiques appliquées) Poncelet publie dans le Journal de Crelle activement parcouru en 1827 (tracé des engrenages de roues d'angle), 1828 (sur les centres de moyennes harmoniques) et 1835 (sur les séries et développements infinis). Mais à partir de 1836, les mathématiciens français vont privilégier pour leurs publications le Journal de mathématiques pures et appliquées, encore appelé Journal de Liouville. -
Bulletin universitaire contenant les ordonnances, réglemens et arrêtés concernant l'instruction publique (1828-1849)Périodiques officiels; 1828-1849;Dessin créé pour communiquer visuellement sur le design, la construction ou sur le fonctionnement d'un objet d'étude (bâtiment, machine, artéfact)
-
Courrier de la Moselle : journal politique, industriel et littéraire (1829-1885)Journalisme et journaux en France - Moselle; 1829-1885;Périodicité : Trihebdomadaire (1829-1882); Six fois par semaine (1er oct. 1882-1885). À partir de 1871 texte en partie identique à celui de : "Courrier de Meurthe-et-Moselle". Variante(s) de l'adresse : Nancy : [s.n.] Le Courrier de la Moselle est créé en 1828 par François Blanc, professeur de géométrie à l'école de dessin de Metz, reconverti dans le journalisme. Le journal est imprimé par Sigibert Lamort. En 1829, "Le Courrier" absorbe "l’Abeille de la Moselle". On peut y lire des articles politiques, écrits sous la plume de Jean-Prosper Billaudel (avocat et préfet de la Moselle), d'Auguste Rolland (peintre), des chroniques agricoles, culturelles, d’histoire locale et les actualités de la société savante de Metz, par le poète Adolphe Rolland. Né à la toute fin de la Restauration, le Courrier de la Moselle profite de la liberté de ton accordé à la presse pendant la Monarchie de Juillet et les années qui ont suivi la Révolution de 1848. A partir de 1852, le régime de Louis-Napoléon Bonaparte impose une censure stricte sur la critique de son pouvoir. Cependant ce contrôle s’amenuise avec le temps, sans jamais complètement disparaitre, et les journaux purent soutenir ouvertement des candidats libéraux dans leurs campagnes électorales. F. Blanc resta à la tête du journal jusqu’en 1870, puis il passa le flambeau à son collaborateur Ernest Réau pour la partie mosellane, avec pour seule consigne de garder une ligne éditoriale en faveur de la démocratie. En juin 1871, la rédaction et l'impression sont transférés à Nancy; le titre devient alors : "Courrier de Meurthe-et-Moselle" mais le journal continue de paraître aussi sous le titre de : "Courrier de la Moselle" pour les abonnés mosellans. François Blanc s'installe à Nancy et y décède en 1886. La relative liberté politique que s’était accordé les journalistes du Courrier de la Moselle disparait avec l’annexion allemande. Sans jamais interdire la parution des journaux en langue française, les autorités vont prendre des mesures de censure importantes afin de diminuer leurs ventes, les obligeant à terme à cesser la publication mosellane. Le Journal sort jusqu'en 1919 pour la Meurthe et Moselle.
-
L'Indépendant : journal politique, industriel et agricole du département de la Moselle (1830-1870)Journalisme et journaux en France - Moselle; 1830-1870;L'Indépendant de la Moselle est fondé le 1er décembre 1830. Il parait trois fois par semaine sous un format qui a plusieurs fois varié. Créé par le Parti constitutionnel, il compte parmi ses fondateurs d’éminents membres du barreau messin et fut souvent considéré comme « l’organe de la préfecture ». Soutenu pour l'impression par Prosper Wittersheim (1781-1838), Gerson Lévy (1784-1864) en est le fondateur et rédacteur en chef jusqu'en 1855. Gendre de Prosper, Joseph Mayer Samuel prend la suite pour la partie imprimerie en 1837. C'est possiblement lui aussi qui signe les articles "Ed. Mayer.". Alfred Mézières (1826-1915), membre de l’Académie Française, encore élève au collège de Metz, débute dans le journalisme en août 1845 en publiant dans l’Indépendant des chroniques théâtrales. Après quarante années d’existence, le journal cesse sa parution en octobre 1870. Joseph Mayer Samuel aurait été en effet incarcéré par les autorités prussiennes.